 Depuis quelques années, des dizaines de rivières et de ruisseaux de la chaîne Brooks et du Parc national de Kobuk Valley, prennent une teinte orange alarmante. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue « Communications Earth and Environment », ce phénomène serait causé par le dégel du pergélisol, qui expose des minéraux auparavant gelés, désormais lessivés dans, et par, les cours d’eau. Chercheur à l'université d'Alaska à Anchorage, Patrick Sullivan écrit : « D'après des relevés effectués sur la rivière Salmon, le pH, qui permet de déterminer la qualité de l'eau, était de 6,4, soit environ 100 fois plus acide que la rivière dans laquelle le cours d'eau se déversait. Autre marqueur inquiétant, la conductivité électrique des métaux était plus proche de celle des eaux usées industrielles que de celle d'un ruisseau de montagne ». D'après l’équipe de recherche, le parc national de Kobuk Valley s'est réchauffé de 2,4°C depuis 2006, et cette élévation de température a déjà fait fondre 40% du permafrost. D'après Patrick Sullivan, la coloration des eaux peut s'expliquer par la présence de fer, mais d’autres chercheurs pensent que la prolifération de bactéries ferreuses, non-dangereuses pour les espèces aquatiques et la santé humaine, est une autre piste probable. Quant à estimer ce que pourrait être l'impact écologique de ce phénomène, il faudra attendre encore un peu…
Depuis quelques années, des dizaines de rivières et de ruisseaux de la chaîne Brooks et du Parc national de Kobuk Valley, prennent une teinte orange alarmante. Selon une nouvelle étude publiée dans la revue « Communications Earth and Environment », ce phénomène serait causé par le dégel du pergélisol, qui expose des minéraux auparavant gelés, désormais lessivés dans, et par, les cours d’eau. Chercheur à l'université d'Alaska à Anchorage, Patrick Sullivan écrit : « D'après des relevés effectués sur la rivière Salmon, le pH, qui permet de déterminer la qualité de l'eau, était de 6,4, soit environ 100 fois plus acide que la rivière dans laquelle le cours d'eau se déversait. Autre marqueur inquiétant, la conductivité électrique des métaux était plus proche de celle des eaux usées industrielles que de celle d'un ruisseau de montagne ». D'après l’équipe de recherche, le parc national de Kobuk Valley s'est réchauffé de 2,4°C depuis 2006, et cette élévation de température a déjà fait fondre 40% du permafrost. D'après Patrick Sullivan, la coloration des eaux peut s'expliquer par la présence de fer, mais d’autres chercheurs pensent que la prolifération de bactéries ferreuses, non-dangereuses pour les espèces aquatiques et la santé humaine, est une autre piste probable. Quant à estimer ce que pourrait être l'impact écologique de ce phénomène, il faudra attendre encore un peu…
Quelques brèves de chez nous et... d'ailleurs


 C’est la Roumanie qui sera à l’honneur du Game Fair 2024. Pays de chasse, la Roumanie est un carrefour culturel au cœur de l’Europe. Situé entre la Hongrie, la Serbie, la Bulgarie, la Moldavie et l’Ukraine, la Roumanie détient la plus grande surface de forêt naturelle de toute l’Europe, réparties en 2 200 territoires de chasse. La diversité faunistique, présentée dans le village dédié, est d’une richesse incomparable : chamois, chevreuils, cerfs, daims, sangliers, mais aussi lynx, loups et ours, dont 8 000 sujets peuplent la région des Carpates, ce qui n’est pas sans poser de problèmes à la population. Côté petit gibier, le delta du Danube possède des concentrations exceptionnelles de sarcelles, siffleurs, pilets, chipeaux et autres souchets. Mais le Game Fair, c’est aussi plus de 80 000 visiteurs qui parcourent les allées des stands des 580 exposants présents. On y trouve toutes les nouveautés : armes, optiques, munitions, vêtements, accessoires ou encore aménagements du territoire, et de nombreux espaces consacrés aux chiens, à la chasse à l’arc, à la pêche, aux couteliers… Durant ces trois jours, de nombreuses animations seront proposées : ball-trap, sanglier courant, tir à l’arc, tir à la carabine à plomb, concours de trompes, concours de chien de chasse, vente aux enchères, messe de Saint-Hubert, vide grenier, spectacle…
C’est la Roumanie qui sera à l’honneur du Game Fair 2024. Pays de chasse, la Roumanie est un carrefour culturel au cœur de l’Europe. Situé entre la Hongrie, la Serbie, la Bulgarie, la Moldavie et l’Ukraine, la Roumanie détient la plus grande surface de forêt naturelle de toute l’Europe, réparties en 2 200 territoires de chasse. La diversité faunistique, présentée dans le village dédié, est d’une richesse incomparable : chamois, chevreuils, cerfs, daims, sangliers, mais aussi lynx, loups et ours, dont 8 000 sujets peuplent la région des Carpates, ce qui n’est pas sans poser de problèmes à la population. Côté petit gibier, le delta du Danube possède des concentrations exceptionnelles de sarcelles, siffleurs, pilets, chipeaux et autres souchets. Mais le Game Fair, c’est aussi plus de 80 000 visiteurs qui parcourent les allées des stands des 580 exposants présents. On y trouve toutes les nouveautés : armes, optiques, munitions, vêtements, accessoires ou encore aménagements du territoire, et de nombreux espaces consacrés aux chiens, à la chasse à l’arc, à la pêche, aux couteliers… Durant ces trois jours, de nombreuses animations seront proposées : ball-trap, sanglier courant, tir à l’arc, tir à la carabine à plomb, concours de trompes, concours de chien de chasse, vente aux enchères, messe de Saint-Hubert, vide grenier, spectacle… Le mélange des casquettes a eu raison de ce qui a été, depuis le départ, un « truc » mal ficelé et mal ciblé, déclenchant une vague catastrophique de démissions. De crédible, l’objectif initial ne faisait plus que des incrédules… Il va donc falloir reconstruire sur des fondations fragilisées, les vrais maux dont souffrent les chasseurs ayant été ignorés tout au long de cette campagne, où primaient plus les ambitions politiques que l’intérêt cynégétique. Pour avoir mis de côté l’un des principaux piliers porteurs de la ruralité, les deux colistiers, initiateurs de cette entrée avortée au Parlement européen, ont oublié que, dans les pavillons de chasse, se côtoient en harmonie tous les milieux sociaux et toutes les appartenances politiques. La seule bonne nouvelle de cette élection est l’affaiblissement bien mérité des verts, qui paient l’écologie punitive qu’ils veulent imposer, dont nous commençons seulement à payer le prix fort… et ça n’est pas fini. Les partis politiques de tous bords vont nous ignorer le temps de la campagne des législatives, et auront à se mettre au travail dès l’été. Que se passera-t-il après ?
Le mélange des casquettes a eu raison de ce qui a été, depuis le départ, un « truc » mal ficelé et mal ciblé, déclenchant une vague catastrophique de démissions. De crédible, l’objectif initial ne faisait plus que des incrédules… Il va donc falloir reconstruire sur des fondations fragilisées, les vrais maux dont souffrent les chasseurs ayant été ignorés tout au long de cette campagne, où primaient plus les ambitions politiques que l’intérêt cynégétique. Pour avoir mis de côté l’un des principaux piliers porteurs de la ruralité, les deux colistiers, initiateurs de cette entrée avortée au Parlement européen, ont oublié que, dans les pavillons de chasse, se côtoient en harmonie tous les milieux sociaux et toutes les appartenances politiques. La seule bonne nouvelle de cette élection est l’affaiblissement bien mérité des verts, qui paient l’écologie punitive qu’ils veulent imposer, dont nous commençons seulement à payer le prix fort… et ça n’est pas fini. Les partis politiques de tous bords vont nous ignorer le temps de la campagne des législatives, et auront à se mettre au travail dès l’été. Que se passera-t-il après ? Le symposium international « One H » organisé par l’Anses, le laboratoire d’analyse Labocea, le technopole Innozh et le Palais des congrès et des expositions de Saint-Brieuc, rassemblera les acteurs de la santé animale, environnementale et humaine, pour mener une réflexion globale sur la transmission des maladies infectieuses des animaux aux êtres humains. Du 12 au 14 juin, à Saint-Brieuc, des scientifiques, des professionnels du secteur privé et des responsables politiques échangeront sur les principaux défis à relever pour lutter contre les maladies infectieuses. Les questions abordées se déclineront en cinq thématiques :
Le symposium international « One H » organisé par l’Anses, le laboratoire d’analyse Labocea, le technopole Innozh et le Palais des congrès et des expositions de Saint-Brieuc, rassemblera les acteurs de la santé animale, environnementale et humaine, pour mener une réflexion globale sur la transmission des maladies infectieuses des animaux aux êtres humains. Du 12 au 14 juin, à Saint-Brieuc, des scientifiques, des professionnels du secteur privé et des responsables politiques échangeront sur les principaux défis à relever pour lutter contre les maladies infectieuses. Les questions abordées se déclineront en cinq thématiques : En Suisse, une étude menée au plan national sur les proies consommées par les loups, a livré quelques surprises. Sur 347 échantillons de fèces de ces prédateurs analysées, 83% des proies sont des animaux sauvages et 17% des animaux de rente. La fondation Kora, qui publie l'étude, précise toutefois que rien ne permet d'affirmer que tout ce qui a été mangé a été tué par les loups, qui peuvent aussi consommer de la charogne. Dans le détail, les loups suisses mangent en moyenne 36% de cerfs, qui constituent leur principale source de nourriture. Les chamois et les chevreuils complètent le podium avec respectivement 20% et 18%, les renards 3%, les sangliers 2%, et les lièvres, marmottes et bouquetins 1% chacun. Enfin, pour ce qui est des animaux de rente, les repas des loups se composent de 11% de moutons (15% l'été et 9% en hiver) et de 3% de bovins. En Valais, c'est le chamois qui est le plus consommé (30%), alors que le taux de moutons est légèrement plus élevé que la moyenne nationale suisse, avec 13%. À noter que les analyses ont été réalisées par l'Université de Lausanne. Actuellement, 35 meutes de loups évoluent sur le territoire suisse, dont plusieurs sont transfrontalières avec la France et l’Italie. La majorité des meutes sont comptabilisées dans les Alpes, au sud de la Suisse : 13 sont installées en Valais et 15 autres aux Grisons, au Tessin et dans le canton de Glaris.
En Suisse, une étude menée au plan national sur les proies consommées par les loups, a livré quelques surprises. Sur 347 échantillons de fèces de ces prédateurs analysées, 83% des proies sont des animaux sauvages et 17% des animaux de rente. La fondation Kora, qui publie l'étude, précise toutefois que rien ne permet d'affirmer que tout ce qui a été mangé a été tué par les loups, qui peuvent aussi consommer de la charogne. Dans le détail, les loups suisses mangent en moyenne 36% de cerfs, qui constituent leur principale source de nourriture. Les chamois et les chevreuils complètent le podium avec respectivement 20% et 18%, les renards 3%, les sangliers 2%, et les lièvres, marmottes et bouquetins 1% chacun. Enfin, pour ce qui est des animaux de rente, les repas des loups se composent de 11% de moutons (15% l'été et 9% en hiver) et de 3% de bovins. En Valais, c'est le chamois qui est le plus consommé (30%), alors que le taux de moutons est légèrement plus élevé que la moyenne nationale suisse, avec 13%. À noter que les analyses ont été réalisées par l'Université de Lausanne. Actuellement, 35 meutes de loups évoluent sur le territoire suisse, dont plusieurs sont transfrontalières avec la France et l’Italie. La majorité des meutes sont comptabilisées dans les Alpes, au sud de la Suisse : 13 sont installées en Valais et 15 autres aux Grisons, au Tessin et dans le canton de Glaris.  Dans la Haute-Vienne, le paisible village d’Oradour-sur-Glane a connu l’horreur absolue quand, le 10 juin 1944, une division SS massacra systématiquement les habitants présents, et fit 643 victimes. L’agglomération a été reconstruite à proximité du village détruit et la vie a repris son cours, mais l’événement reste à jamais gravé dans la mémoire collective. A l’occasion des 80 ans de ce massacre, les écoles primaires et maternelles de la commune ont planté les premiers arbres d'une forêt mémorielle : 205 arbres en mémoire des 205 enfants victimes de la barbarie nazie. L'opération, initiée par la commune, a été pilotée par l'ONF, avec le concours du Fonds forestier en Limousin, de Fransylva en Limousin, du Syndicat national et régional des pépiniéristes forestiers, soutenu par l’Association nationale des familles des martyrs. Cette plantation, labellisée « 80 ans de la libération », se situe non loin du centre bourg d’Oradour-sur-Glane, en bord de rivière à proximité d’un sentier prisé par les habitants de la commune… pour ne jamais oublier. « Nous avons retenu le chêne pédonculé, le chêne des marais, le pin sylvestre et le cyprès chauve notamment pour leurs qualités paysagères. Cette plantation est l’occasion de sensibiliser les enfants à toutes les vertus des arbres, y compris sa symbolique, car l’homme a souvent planté des arbres pour se souvenir » a déclaré Jérôme Vany, technicien ONF qui accompagne la commune dans ce projet. Aujourd’hui, 10 juin, date anniversaire du massacre, en présence du Président de la République (si ce déplacement est maintenu pour les raisons que l'on sait) et de nombreuses personnalités, sera planté un 206e arbre symbolisant l'ensemble des victimes.
Dans la Haute-Vienne, le paisible village d’Oradour-sur-Glane a connu l’horreur absolue quand, le 10 juin 1944, une division SS massacra systématiquement les habitants présents, et fit 643 victimes. L’agglomération a été reconstruite à proximité du village détruit et la vie a repris son cours, mais l’événement reste à jamais gravé dans la mémoire collective. A l’occasion des 80 ans de ce massacre, les écoles primaires et maternelles de la commune ont planté les premiers arbres d'une forêt mémorielle : 205 arbres en mémoire des 205 enfants victimes de la barbarie nazie. L'opération, initiée par la commune, a été pilotée par l'ONF, avec le concours du Fonds forestier en Limousin, de Fransylva en Limousin, du Syndicat national et régional des pépiniéristes forestiers, soutenu par l’Association nationale des familles des martyrs. Cette plantation, labellisée « 80 ans de la libération », se situe non loin du centre bourg d’Oradour-sur-Glane, en bord de rivière à proximité d’un sentier prisé par les habitants de la commune… pour ne jamais oublier. « Nous avons retenu le chêne pédonculé, le chêne des marais, le pin sylvestre et le cyprès chauve notamment pour leurs qualités paysagères. Cette plantation est l’occasion de sensibiliser les enfants à toutes les vertus des arbres, y compris sa symbolique, car l’homme a souvent planté des arbres pour se souvenir » a déclaré Jérôme Vany, technicien ONF qui accompagne la commune dans ce projet. Aujourd’hui, 10 juin, date anniversaire du massacre, en présence du Président de la République (si ce déplacement est maintenu pour les raisons que l'on sait) et de nombreuses personnalités, sera planté un 206e arbre symbolisant l'ensemble des victimes.  - Aveyron : les faits se sont déroulés le samedi 1er juin, au Fel, sur un troupeau de bovins. Vers 6h30, Robert Lavigne est réveillé par le meuglement des vaches et des veaux. Alerté, il sort pour constater que son troupeau a cassé les fils électriques de l’enclos pour se réfugier dans le corps de ferme, sauf deux vaches, la matriarche et une autre qui venait de vêler. Le veau est mutilé et la mère qui a voulu le défendre est en détresse. Quant à la matriarche, elle sera retrouvée reposant sur le flanc, à moitié dans le ruisseau en contrebas, avec une patte cassée, et sera euthanasiée par le vétérinaire. La gendarmerie et l’OFB ont été prévenus et des prélèvements ADN ont été effectués. La semaine précédente, c’est le frère de l’éleveur qui avait aussi subi une attaque sur son troupeau de brebis. Le ou les prédateurs en ont égorgé 8 qui sont mortes, 8 autres ont été blessées grièvement et ont dû être euthanasiées et 13 brebis et le bélier ont subi des morsures profondes.
- Aveyron : les faits se sont déroulés le samedi 1er juin, au Fel, sur un troupeau de bovins. Vers 6h30, Robert Lavigne est réveillé par le meuglement des vaches et des veaux. Alerté, il sort pour constater que son troupeau a cassé les fils électriques de l’enclos pour se réfugier dans le corps de ferme, sauf deux vaches, la matriarche et une autre qui venait de vêler. Le veau est mutilé et la mère qui a voulu le défendre est en détresse. Quant à la matriarche, elle sera retrouvée reposant sur le flanc, à moitié dans le ruisseau en contrebas, avec une patte cassée, et sera euthanasiée par le vétérinaire. La gendarmerie et l’OFB ont été prévenus et des prélèvements ADN ont été effectués. La semaine précédente, c’est le frère de l’éleveur qui avait aussi subi une attaque sur son troupeau de brebis. Le ou les prédateurs en ont égorgé 8 qui sont mortes, 8 autres ont été blessées grièvement et ont dû être euthanasiées et 13 brebis et le bélier ont subi des morsures profondes.  - Charente : de plus en plus présentes en Charente, un agriculteur de Genac a immortalisé le passage d’une quarantaine de cigognes dans les prairies des bords de Charente. « Une belle surprise » raconte Nicolas Suanez, également chasseur d’orages et passionné de météorologie. L’été dernier, un phénomène similaire s’était produit à Valoparc, où 200 cigognes ont été observées. Attirés par la nourriture des déchets ménagers, ces oiseaux ont été le spectacle de la journée.
- Charente : de plus en plus présentes en Charente, un agriculteur de Genac a immortalisé le passage d’une quarantaine de cigognes dans les prairies des bords de Charente. « Une belle surprise » raconte Nicolas Suanez, également chasseur d’orages et passionné de météorologie. L’été dernier, un phénomène similaire s’était produit à Valoparc, où 200 cigognes ont été observées. Attirés par la nourriture des déchets ménagers, ces oiseaux ont été le spectacle de la journée. Réunis en assemblée générale sous la présidence du Docteur Alain François, les cotateurs de l’Association Française pour la Mensuration des Trophées (AFMT), ont pu prendre connaissance du bilan annuel des cotations enregistrées, présenté par Jean-Philippe Chavane de Dalmatie. Les chiffres sont plaisants à lire puisqu’ils font état de 1528 nouveaux trophées, qui ont ainsi été homologués, et répartis comme suit : 561 cerfs, 631 chevreuils, 190 sangliers, 27 mouflons, 64 chamois, 54 isards et 1 daim. C’est donc grâce à ce réseau des cotateurs de l’AFMT répartis dans tout l’hexagone, discrets mais oh combien efficaces, que la France est le pays européen qui possède la plus importante base de données intéressant les trophées d’ongulés, ce dont s’est félicité le Docteur Alain François, qui s’est dit fier de présider l’AFMT, laquelle est devenue une belle association. Sur notre photo : le président de l’AMFT, entouré de ses proches collaborateurs : Jean-Philippe Chavane et Jacky Martin.
Réunis en assemblée générale sous la présidence du Docteur Alain François, les cotateurs de l’Association Française pour la Mensuration des Trophées (AFMT), ont pu prendre connaissance du bilan annuel des cotations enregistrées, présenté par Jean-Philippe Chavane de Dalmatie. Les chiffres sont plaisants à lire puisqu’ils font état de 1528 nouveaux trophées, qui ont ainsi été homologués, et répartis comme suit : 561 cerfs, 631 chevreuils, 190 sangliers, 27 mouflons, 64 chamois, 54 isards et 1 daim. C’est donc grâce à ce réseau des cotateurs de l’AFMT répartis dans tout l’hexagone, discrets mais oh combien efficaces, que la France est le pays européen qui possède la plus importante base de données intéressant les trophées d’ongulés, ce dont s’est félicité le Docteur Alain François, qui s’est dit fier de présider l’AFMT, laquelle est devenue une belle association. Sur notre photo : le président de l’AMFT, entouré de ses proches collaborateurs : Jean-Philippe Chavane et Jacky Martin. Cependant, cela n'est pas sans problèmes pour les populations, car les éléphants détruisent de plus en plus les récoltes, les provisions, les semences pour une population qui vit essentiellement de l'agriculture de subsistance, sans occulter les personnes qui sont blessées ou tuées, lors d'affrontements. La concentration d’animaux, sur les surfaces encore disponibles est telle que des chercheurs de l’université de Potsdam, en Allemagne, qui mènent des recherches sur le terrain ont qualifié les pachydermes de « tueurs climatiques ». Les animaux modifient des paysages entiers en raison de leur forte densité, détruisant leur propre habitat et celui de dizaines d’autres espèces animales et végétales, leur bilan carbone est de plus en plus défavorable, et ils n’apportent, en l’absence de chasse, aucune valeur ajoutée. Dénonçant une Europe qui s’érige en forteresse verte contre la chasse, la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe, l’Afrique du Sud déplorent le manque de concertation. Figure de proue de la revendication, le président du Botswana, le docteur Masisi, a déclaré : « Trop de pays européens, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France, ont un point commun : bien qu’ils fassent partie d’accords commerciaux internationaux (CITES, UICN…), Londres, Berlin et Paris manquent cruellement de concertation avec les partenaires… Nous, les défenseurs de la faune sauvage les plus performants au monde, en particulier en ce qui concerne notre espèce majestueuse qu'est l'éléphant, j'aimerais que le monde reconnaisse les sacrifices que nous consentons pour réussir ainsi… ». Quant au ministre namibien de l'Environnement et du Tourisme, Pohamba Shifeta, il ajoute : « Les espèces sauvages ont besoin d'une gestion durable et réglementée pour garantir la conservation de leurs populations et de leurs habitats, ainsi que pour éviter tout dommage à notre agriculture et à nos forêts. Dans notre pays, les revenus provenant de toute forme d'utilisation durable sont essentiels pour atteindre nos objectifs nationaux et internationaux en matière de protection du climat en préservant les habitats, en garantissant les droits de l'homme par l'emploi et la sécurité alimentaire, et en développant une économie florissante de la faune sauvage grâce à un tourisme et une chasse équilibrée… Alors que tous les grands mammifères terrestres ont été exterminés en Europe et sont en train de revenir lentement, l’Afrique australe n’a jamais oublié comment vivre avec, et à leurs côtés. Les pays du Nord feraient bien de s’informer là où la conservation réussie des espèces, la préservation des emplois, l’éducation et la sécurité alimentaire ainsi qu’une contribution massive à la protection du climat mondial sont des enjeux quotidiens : en Afrique australe, en Asie centrale et en Amérique du Nord… ».
Cependant, cela n'est pas sans problèmes pour les populations, car les éléphants détruisent de plus en plus les récoltes, les provisions, les semences pour une population qui vit essentiellement de l'agriculture de subsistance, sans occulter les personnes qui sont blessées ou tuées, lors d'affrontements. La concentration d’animaux, sur les surfaces encore disponibles est telle que des chercheurs de l’université de Potsdam, en Allemagne, qui mènent des recherches sur le terrain ont qualifié les pachydermes de « tueurs climatiques ». Les animaux modifient des paysages entiers en raison de leur forte densité, détruisant leur propre habitat et celui de dizaines d’autres espèces animales et végétales, leur bilan carbone est de plus en plus défavorable, et ils n’apportent, en l’absence de chasse, aucune valeur ajoutée. Dénonçant une Europe qui s’érige en forteresse verte contre la chasse, la Namibie, le Botswana, le Zimbabwe, l’Afrique du Sud déplorent le manque de concertation. Figure de proue de la revendication, le président du Botswana, le docteur Masisi, a déclaré : « Trop de pays européens, dont le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France, ont un point commun : bien qu’ils fassent partie d’accords commerciaux internationaux (CITES, UICN…), Londres, Berlin et Paris manquent cruellement de concertation avec les partenaires… Nous, les défenseurs de la faune sauvage les plus performants au monde, en particulier en ce qui concerne notre espèce majestueuse qu'est l'éléphant, j'aimerais que le monde reconnaisse les sacrifices que nous consentons pour réussir ainsi… ». Quant au ministre namibien de l'Environnement et du Tourisme, Pohamba Shifeta, il ajoute : « Les espèces sauvages ont besoin d'une gestion durable et réglementée pour garantir la conservation de leurs populations et de leurs habitats, ainsi que pour éviter tout dommage à notre agriculture et à nos forêts. Dans notre pays, les revenus provenant de toute forme d'utilisation durable sont essentiels pour atteindre nos objectifs nationaux et internationaux en matière de protection du climat en préservant les habitats, en garantissant les droits de l'homme par l'emploi et la sécurité alimentaire, et en développant une économie florissante de la faune sauvage grâce à un tourisme et une chasse équilibrée… Alors que tous les grands mammifères terrestres ont été exterminés en Europe et sont en train de revenir lentement, l’Afrique australe n’a jamais oublié comment vivre avec, et à leurs côtés. Les pays du Nord feraient bien de s’informer là où la conservation réussie des espèces, la préservation des emplois, l’éducation et la sécurité alimentaire ainsi qu’une contribution massive à la protection du climat mondial sont des enjeux quotidiens : en Afrique australe, en Asie centrale et en Amérique du Nord… ». Piloté par le ministère de la Transition écologique, et doté de 10 millions d’euros, ce projet, lancé le 1er septembre 2022, ambitionne d’apporter une réponse concrète et rapide au besoin de nature de la population, et à favoriser le développement d’un tourisme durable, avec la création ou réhabilitation de 1 000 km de sentiers. Succès total, puisque sur les 150 projets qui ont été soumis, 89 ont été retenus dans l’Hexagone et en Outre-Mer, et ce ne sont pas 1 000, mais 1 400 km de sentiers de randonnée pédestre, qui mettront en valeur le patrimoine naturel, culturel et paysager sur leurs abords. Les études préalables et travaux d’aménagement de sentiers, les actions pour l’accueil du public et la pédagogie, les aménagements et travaux pour la protection et la restauration de la biodiversité et des paysages aux abords du sentier ont été financés jusqu'à 80 % pour certains, portés par des collectivités (communes, métropoles, départements…), des parcs nationaux et naturels régionaux, des associations gestionnaires d’espaces naturels et des établissements publics. Les lauréats illustrent la diversité des approches, que ce soit dans une logique de tourisme ou de préservation de l’environnement. Dans l’Hexagone et en Outre-Mer, en zones touristiques très fréquentées, proches d’agglomérations, ou dans des communes rurales, les projets sélectionnés participent tous au développement d’un tourisme durable. Les projets sont situés majoritairement en zone naturelle, mais ils développent aussi le lien ville-campagne.
Piloté par le ministère de la Transition écologique, et doté de 10 millions d’euros, ce projet, lancé le 1er septembre 2022, ambitionne d’apporter une réponse concrète et rapide au besoin de nature de la population, et à favoriser le développement d’un tourisme durable, avec la création ou réhabilitation de 1 000 km de sentiers. Succès total, puisque sur les 150 projets qui ont été soumis, 89 ont été retenus dans l’Hexagone et en Outre-Mer, et ce ne sont pas 1 000, mais 1 400 km de sentiers de randonnée pédestre, qui mettront en valeur le patrimoine naturel, culturel et paysager sur leurs abords. Les études préalables et travaux d’aménagement de sentiers, les actions pour l’accueil du public et la pédagogie, les aménagements et travaux pour la protection et la restauration de la biodiversité et des paysages aux abords du sentier ont été financés jusqu'à 80 % pour certains, portés par des collectivités (communes, métropoles, départements…), des parcs nationaux et naturels régionaux, des associations gestionnaires d’espaces naturels et des établissements publics. Les lauréats illustrent la diversité des approches, que ce soit dans une logique de tourisme ou de préservation de l’environnement. Dans l’Hexagone et en Outre-Mer, en zones touristiques très fréquentées, proches d’agglomérations, ou dans des communes rurales, les projets sélectionnés participent tous au développement d’un tourisme durable. Les projets sont situés majoritairement en zone naturelle, mais ils développent aussi le lien ville-campagne. De plus, la politique tarifaire de certaines compagnies aériennes permet, voire encourage le trafic, en offrant un doublement du poids des bagages pour une somme dérisoire, comparée au prix du billet d’avion, et au prix de revente des marchandises sur le territoire européen. Ce trafic porte donc une grave atteinte à la biodiversité, s’agissant de produits animaux ou d’animaux vivants, issus d’espèces protégées. Bien que de nombreuses recommandations aient été émises depuis plusieurs années, par des missions d’inspection, des parlementaires ou des organisations non gouvernementales, force est de constater qu’elles n’ont pas été suivies d’effet, ou n’ont pas donné les résultats attendus. Le groupe de travail interministériel constitué en 2023 envisage donc :
De plus, la politique tarifaire de certaines compagnies aériennes permet, voire encourage le trafic, en offrant un doublement du poids des bagages pour une somme dérisoire, comparée au prix du billet d’avion, et au prix de revente des marchandises sur le territoire européen. Ce trafic porte donc une grave atteinte à la biodiversité, s’agissant de produits animaux ou d’animaux vivants, issus d’espèces protégées. Bien que de nombreuses recommandations aient été émises depuis plusieurs années, par des missions d’inspection, des parlementaires ou des organisations non gouvernementales, force est de constater qu’elles n’ont pas été suivies d’effet, ou n’ont pas donné les résultats attendus. Le groupe de travail interministériel constitué en 2023 envisage donc : 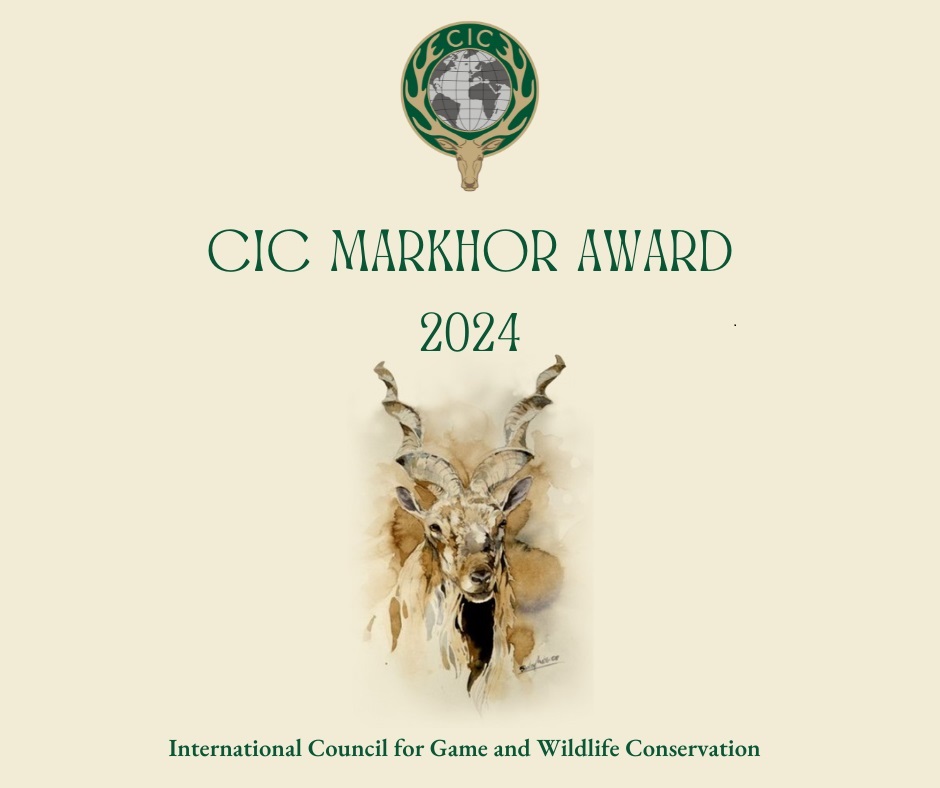 Le prix CIC Markhor récompense un projet de conservation d'importance mondiale, qui relie la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité aux moyens de subsistance humains. Décerné tous les deux ans, il sera remis à l'occasion de la Conférence des Parties, à la Convention sur la diversité biologique (CDB), qui se tiendra du 21 octobre au 1er novembre 2024 à Cali, en Colombie. Ce prestigieux « Prix CIC Markhor » dont ce sera la 8e édition, récompensera les meilleures pratiques dans le domaine de l'utilisation durable. Pour marquer cette occasion spéciale, un appel à candidatures est ouvert pour coïncider avec la première Journée internationale du Markhor, qui reconnaît l'importance de cette espèce emblématique de chèvre sauvage. Si vous connaissez des initiatives d'utilisation durable liées à une espèce sauvage qui mériteraient ce prix, vous pouvez contacter le CIC et envoyer une courte description de la réalisation. L'accent sera mis sur la conservation ou la réintroduction de la biodiversité par la chasse, dans le cadre de programmes de gestion durable du gibier, de la faune et de l'habitat. Une attention particulière sera accordée aux projets qui ont une pertinence
Le prix CIC Markhor récompense un projet de conservation d'importance mondiale, qui relie la conservation et l'utilisation durable de la biodiversité aux moyens de subsistance humains. Décerné tous les deux ans, il sera remis à l'occasion de la Conférence des Parties, à la Convention sur la diversité biologique (CDB), qui se tiendra du 21 octobre au 1er novembre 2024 à Cali, en Colombie. Ce prestigieux « Prix CIC Markhor » dont ce sera la 8e édition, récompensera les meilleures pratiques dans le domaine de l'utilisation durable. Pour marquer cette occasion spéciale, un appel à candidatures est ouvert pour coïncider avec la première Journée internationale du Markhor, qui reconnaît l'importance de cette espèce emblématique de chèvre sauvage. Si vous connaissez des initiatives d'utilisation durable liées à une espèce sauvage qui mériteraient ce prix, vous pouvez contacter le CIC et envoyer une courte description de la réalisation. L'accent sera mis sur la conservation ou la réintroduction de la biodiversité par la chasse, dans le cadre de programmes de gestion durable du gibier, de la faune et de l'habitat. Une attention particulière sera accordée aux projets qui ont une pertinence  multinationale, en particulier les projets qui impliquent une coopération transfrontalière et des partenariats innovants pour la conservation et la gestion communautaire des ressources naturelles. Les candidats éligibles sont :
multinationale, en particulier les projets qui impliquent une coopération transfrontalière et des partenariats innovants pour la conservation et la gestion communautaire des ressources naturelles. Les candidats éligibles sont :