- Alpes-Maritimes : un visiteur pour le moins inhabituel a surpris habitants et touristes, jeudi dernier, à Valberg. Un imposant cerf a été découvert, allongé, devant un immeuble de la station de ski, attirant immédiatement l’attention des passants intrigués. L’animal, visiblement affaibli et blessé à l’arrière-train, semblait incapable de se relever, probablement épuisé après avoir erré à proximité des habitations. Face à la situation, les autorités ont rapidement sécurisé les lieux. Un périmètre de protection a été installé afin d’assurer la sécurité du cervidé comme celle du public, particulièrement nombreux en cette période de vacances scolaires d’hiver. La présence de nombreux vacanciers rendait l’intervention d’autant plus délicate. Gendarmes, agents municipaux et sapeurs-pompiers se sont mobilisés pour gérer l’incident. Dans l’après-midi, le service vétérinaire du SDIS 06 est intervenu pour endormir l’animal en toute sécurité. Une fois tranquillisé, le cerf a pu être transporté vers un endroit plus calme et adapté à sa prise en charge. Sept pompiers ont participé à cette opération.
- Ariège : trois zones de protection contre la prédation de l’ours sont définies en Occitanie pour 2026, avec des niveaux d’aides adaptés à l’intensité du risque. Les éleveurs et groupements pastoraux peuvent déposer leur demande d’ici au 31 juillet 2026. Les dépenses sont éligibles depuis le 3 février 2025 (ou un mois avant la demande pour le gardiennage) et, pour les autres frais, depuis le 1er janvier 2026. Dans les cercles 0 et 1, au moins deux mesures doivent être mises en place (gardiennage, chiens de protection ou clôtures). Dans le cercle 2, une seule mesure (chien ou clôture) suffit.  Le nouveau « cercle 0 » cible les zones les plus exposées, notamment en Ariège et en Haute-Garonne, avec au moins dix attaques annuelles en moyenne sur trois ans. Il permet un financement à 100 % du gardiennage renforcé pour les structures collectives. Les cercles 1 et 2, relativement stables par rapport à 2025, couvrent respectivement les communes avec indices récents de présence d’ours et une zone tampon préventive. Début février, la préfecture de région Occitanie a publié la liste des communes concernées, rappelant que l’ours, espèce strictement protégée et opportuniste, demeure présent dans le massif pyrénéen.
Le nouveau « cercle 0 » cible les zones les plus exposées, notamment en Ariège et en Haute-Garonne, avec au moins dix attaques annuelles en moyenne sur trois ans. Il permet un financement à 100 % du gardiennage renforcé pour les structures collectives. Les cercles 1 et 2, relativement stables par rapport à 2025, couvrent respectivement les communes avec indices récents de présence d’ours et une zone tampon préventive. Début février, la préfecture de région Occitanie a publié la liste des communes concernées, rappelant que l’ours, espèce strictement protégée et opportuniste, demeure présent dans le massif pyrénéen.
- Charente : la forêt domaniale de la Braconne a été le théâtre d’une compétition d’exception du 12 au 15 février : la Coupe de France sur sanglier organisée par la Société centrale canine. Pendant quatre jours, les douze meilleures meutes de France, qualifiées à l’issue d’épreuves régionales, se sont affrontées dans des conditions de chasse grandeur nature, sous l’œil attentif des juges et d’un public averti. Au terme de prestations saluées pour leur rigueur et leur cohésion, les Porcelaines de l’équipage des Hurleurs du Minervois, conduites par Willy Berdeil, ont remporté le titre suprême, à la fois par lot et en individuel. Une performance rare qui consacre la qualité du travail de sélection, d’entraînement et de conduite de cette meute originaire du sud de la France.  Les chiens ont été évalués sur plusieurs critères : quête, rapproche, fermeté sur animal, cohésion de meute et maîtrise de la voix, élément clé dans la chasse au sanglier. Les juges ont souligné la régularité et l’intelligence de chasse des Porcelaines, capables de maintenir une pression constante sur l’animal tout en conservant discipline et coordination. Derrière eux, d’autres équipages réputés ont également livré de belles démonstrations, confirmant le haut niveau national de la chasse aux chiens courants. Organisée tous les quatre ans, à l’image des grandes compétitions sportives internationales, la Coupe de France constitue l’événement phare de la discipline. Elle valorise non seulement les qualités cynégétiques des meutes, mais aussi le savoir-faire des éleveurs et conducteurs. Les vainqueurs savourent désormais un sacre prestigieux qui restera inscrit au palmarès jusqu’à la prochaine édition, programmée en 2030.
Les chiens ont été évalués sur plusieurs critères : quête, rapproche, fermeté sur animal, cohésion de meute et maîtrise de la voix, élément clé dans la chasse au sanglier. Les juges ont souligné la régularité et l’intelligence de chasse des Porcelaines, capables de maintenir une pression constante sur l’animal tout en conservant discipline et coordination. Derrière eux, d’autres équipages réputés ont également livré de belles démonstrations, confirmant le haut niveau national de la chasse aux chiens courants. Organisée tous les quatre ans, à l’image des grandes compétitions sportives internationales, la Coupe de France constitue l’événement phare de la discipline. Elle valorise non seulement les qualités cynégétiques des meutes, mais aussi le savoir-faire des éleveurs et conducteurs. Les vainqueurs savourent désormais un sacre prestigieux qui restera inscrit au palmarès jusqu’à la prochaine édition, programmée en 2030.
- Côte d’Or : passionné par l’univers cynégétique et inspiré par le thème « Ambiance de chasse », ce concours est fait pour vous. À l’occasion de l’exposition des trophées organisée les 17, 18 et 19 avril au Palais des Congrès de Beaune, la FDC 21 lance un concours photo gratuit. Les participants sont invités à proposer un cliché illustrant l’atmosphère de la chasse : paysages, traditions, instants de convivialité ou moments de vie, dans un esprit respectueux. Les photographies retenues seront exposées durant les trois jours de l’événement et soumises au vote du public. Le concours est ouvert à toute personne majeure appartenant au monde de la chasse, chasseurs ou proches, à condition d’avoir signé et transmis le règlement. Une seule photo par participant est autorisée. Les images doivent être envoyées au format JPEG par courriel à communication@fdc21.com. À noter : toute image générée ou modifiée par intelligence artificielle est strictement interdite...
[ LIRE LA SUITE... ]
 Il s’agit d’un événement international majeur où fabricants, distributeurs, revendeurs spécialisés et médias se rencontrent pour échanger sur l’état du marché et les tendances futures. Sur quatre jours, des centaines d’exposants venus du monde entier exposent une vaste gamme d’équipements : armes à feu et munitions pour la chasse et le tir sportif, composants et accessoires spécialisés, optiques et électroniques, couteaux, vêtements techniques, accessoires outdoor, ainsi que des solutions pour la sécurité civile et la protection personnelle. Cet ensemble vise à couvrir tous les besoins des professionnels et des spécialistes du secteur. L’événement n’est pas seulement une vitrine de produits : il sert aussi de plateforme pour le réseautage professionnel, les négociations commerciales et l’identification de nouvelles opportunités de marché. Les visiteurs, exclusivement professionnels, peuvent ainsi rencontrer des décideurs, établir des contacts commerciaux durables, et découvrir les innovations qui façonneront l’industrie au cours des prochaines années. Les portes de l’IWA OutdoorClassics sont ouvertes chaque jour avec des horaires adaptés aux visiteurs professionnels, généralement de 09h00 à 18h00 (jusqu’à 16h00 le dernier jour), facilitant ainsi les rencontres et les échanges sur place. Un rendez-vous incontournable ouvert sur les dernières tendances et innovations.
Il s’agit d’un événement international majeur où fabricants, distributeurs, revendeurs spécialisés et médias se rencontrent pour échanger sur l’état du marché et les tendances futures. Sur quatre jours, des centaines d’exposants venus du monde entier exposent une vaste gamme d’équipements : armes à feu et munitions pour la chasse et le tir sportif, composants et accessoires spécialisés, optiques et électroniques, couteaux, vêtements techniques, accessoires outdoor, ainsi que des solutions pour la sécurité civile et la protection personnelle. Cet ensemble vise à couvrir tous les besoins des professionnels et des spécialistes du secteur. L’événement n’est pas seulement une vitrine de produits : il sert aussi de plateforme pour le réseautage professionnel, les négociations commerciales et l’identification de nouvelles opportunités de marché. Les visiteurs, exclusivement professionnels, peuvent ainsi rencontrer des décideurs, établir des contacts commerciaux durables, et découvrir les innovations qui façonneront l’industrie au cours des prochaines années. Les portes de l’IWA OutdoorClassics sont ouvertes chaque jour avec des horaires adaptés aux visiteurs professionnels, généralement de 09h00 à 18h00 (jusqu’à 16h00 le dernier jour), facilitant ainsi les rencontres et les échanges sur place. Un rendez-vous incontournable ouvert sur les dernières tendances et innovations.

 Les veneurs contestent fermement cette hypothèse. Les expertises médico-légales évoquent d’abord la possibilité d’une attaque en meute, mais l’enquête s’oriente progressivement vers Curtis, un American Pitbull Terrier. Un rapport vétérinaire rendu le 31 octobre 2020, fondé sur l’examen comparatif des mâchoires de 67 chiens (ceux du couple et ceux de l’équipage de chasse), conclut que Curtis est l’unique auteur des morsures mortelles. Une analyse génétique vient confirmer ces conclusions. Les demandes de contre-expertise formulées par la défense sont rejetées. Le 4 mars 2021, Christophe Ellul est mis en examen pour homicide involontaire. L’accusation lui reproche notamment un manquement à ses obligations de prudence et évoque un possible dressage au mordant, ainsi que l’irrégularité supposée de l’introduction du chien en France. La dangerosité de l’animal est également relevée après des morsures survenues postérieurement aux faits. Les éléments de téléphonie occupent une place centrale dans le dossier : des photos prises peu avant le drame montrent le chien non muselé, et un SMS envoyé par Christophe Ellul (« Je le fais piquer ») alimente les débats sur sa connaissance des faits. Christophe Ellul, laissé libre sous contrôle judiciaire, encourt jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Le procès devra déterminer les responsabilités exactes dans ce drame qui avait profondément marqué l’opinion publique et ravivé les tensions autour de la chasse à courre et des chiens dits dangereux.
Les veneurs contestent fermement cette hypothèse. Les expertises médico-légales évoquent d’abord la possibilité d’une attaque en meute, mais l’enquête s’oriente progressivement vers Curtis, un American Pitbull Terrier. Un rapport vétérinaire rendu le 31 octobre 2020, fondé sur l’examen comparatif des mâchoires de 67 chiens (ceux du couple et ceux de l’équipage de chasse), conclut que Curtis est l’unique auteur des morsures mortelles. Une analyse génétique vient confirmer ces conclusions. Les demandes de contre-expertise formulées par la défense sont rejetées. Le 4 mars 2021, Christophe Ellul est mis en examen pour homicide involontaire. L’accusation lui reproche notamment un manquement à ses obligations de prudence et évoque un possible dressage au mordant, ainsi que l’irrégularité supposée de l’introduction du chien en France. La dangerosité de l’animal est également relevée après des morsures survenues postérieurement aux faits. Les éléments de téléphonie occupent une place centrale dans le dossier : des photos prises peu avant le drame montrent le chien non muselé, et un SMS envoyé par Christophe Ellul (« Je le fais piquer ») alimente les débats sur sa connaissance des faits. Christophe Ellul, laissé libre sous contrôle judiciaire, encourt jusqu’à dix ans d’emprisonnement et 150 000 euros d’amende. Le procès devra déterminer les responsabilités exactes dans ce drame qui avait profondément marqué l’opinion publique et ravivé les tensions autour de la chasse à courre et des chiens dits dangereux. Ce barème national fixe les bases communes applicables sur l’ensemble du territoire. Il précise notamment le coût horaire de la main-d’œuvre retenu pour les travaux, les fourchettes d’indemnisation, les tarifs moyens des outils et des interventions mécaniques, ainsi que les modalités de prise en compte des semences, des traitements et des conditions particulières liées aux différents contextes pédoclimatiques. L’objectif est d’assurer une harmonisation des pratiques tout en encadrant les montants versés. À partir de ce cadre national, chaque département doit établir sa propre grille d’indemnisation, en restant dans les fourchettes définies, mais en tenant compte des réalités locales : types de prairies, pratiques agricoles, coûts des prestations ou spécificités des territoires. Une fois validé, le barème départemental s’appliquera pour toute l’année 2026. La demande d’indemnisation pour les travaux de remise en état n’exclut pas celle relative à une éventuelle perte de récolte, qui pourra faire l’objet d’une procédure distincte dont les modalités seront précisées ultérieurement. Lors du vote, la Coordination Rurale et la Confédération paysanne se sont abstenues sur la question du taux horaire d’indemnisation, qu’elles jugent insuffisant au regard du travail supplémentaire imposé aux exploitants concernés.
Ce barème national fixe les bases communes applicables sur l’ensemble du territoire. Il précise notamment le coût horaire de la main-d’œuvre retenu pour les travaux, les fourchettes d’indemnisation, les tarifs moyens des outils et des interventions mécaniques, ainsi que les modalités de prise en compte des semences, des traitements et des conditions particulières liées aux différents contextes pédoclimatiques. L’objectif est d’assurer une harmonisation des pratiques tout en encadrant les montants versés. À partir de ce cadre national, chaque département doit établir sa propre grille d’indemnisation, en restant dans les fourchettes définies, mais en tenant compte des réalités locales : types de prairies, pratiques agricoles, coûts des prestations ou spécificités des territoires. Une fois validé, le barème départemental s’appliquera pour toute l’année 2026. La demande d’indemnisation pour les travaux de remise en état n’exclut pas celle relative à une éventuelle perte de récolte, qui pourra faire l’objet d’une procédure distincte dont les modalités seront précisées ultérieurement. Lors du vote, la Coordination Rurale et la Confédération paysanne se sont abstenues sur la question du taux horaire d’indemnisation, qu’elles jugent insuffisant au regard du travail supplémentaire imposé aux exploitants concernés. Si l’événement se confirme, il pourrait contribuer à de nouveaux records de températures mondiales fin 2026 ou début 2027. El Niño, ou plus précisément l’oscillation australe El Niño (ENSO), correspond à un réchauffement anormal des eaux de surface du Pacifique équatorial central et oriental. Ce phénomène naturel survient en moyenne tous les trois à sept ans et dure généralement neuf à douze mois. Il modifie la circulation atmosphérique à l’échelle planétaire, perturbant les régimes de pluie, les températures et l’intensité des tempêtes. Le précédent épisode, en 2023-2024, a fortement contribué aux records de chaleur mondiaux. Selon le climatologue Zeke Hausfather (Berkeley Earth), il aurait ajouté environ 0,12 °C à la température moyenne mondiale en 2024. L’atmosphère absorbe alors davantage de chaleur libérée par l’océan, accentuant temporairement le réchauffement global d’origine anthropique. Or, les océans n’ont jamais été aussi chauds : 2025 marque la cinquième année consécutive de record de température océanique. Dans ce contexte déjà marqué par le changement climatique, un nouvel épisode El Niño pourrait amplifier les extrêmes météorologiques. Aux États-Unis, il favorise souvent de fortes pluies et des tempêtes hivernales sur la côte Pacifique, tandis qu’il peut retarder la mousson en Inde. En Australie et en Asie du Sud-Est, il accroît les risques de sécheresse et d’incendies. L’Europe, plus indirectement influencée, peut néanmoins subir des répercussions sur ses régimes saisonniers. Si son retour se confirme, El Niño ne serait pas la cause du réchauffement climatique, mais un facteur d’accélération temporaire venant s’ajouter à une tendance de fond déjà préoccupante.
Si l’événement se confirme, il pourrait contribuer à de nouveaux records de températures mondiales fin 2026 ou début 2027. El Niño, ou plus précisément l’oscillation australe El Niño (ENSO), correspond à un réchauffement anormal des eaux de surface du Pacifique équatorial central et oriental. Ce phénomène naturel survient en moyenne tous les trois à sept ans et dure généralement neuf à douze mois. Il modifie la circulation atmosphérique à l’échelle planétaire, perturbant les régimes de pluie, les températures et l’intensité des tempêtes. Le précédent épisode, en 2023-2024, a fortement contribué aux records de chaleur mondiaux. Selon le climatologue Zeke Hausfather (Berkeley Earth), il aurait ajouté environ 0,12 °C à la température moyenne mondiale en 2024. L’atmosphère absorbe alors davantage de chaleur libérée par l’océan, accentuant temporairement le réchauffement global d’origine anthropique. Or, les océans n’ont jamais été aussi chauds : 2025 marque la cinquième année consécutive de record de température océanique. Dans ce contexte déjà marqué par le changement climatique, un nouvel épisode El Niño pourrait amplifier les extrêmes météorologiques. Aux États-Unis, il favorise souvent de fortes pluies et des tempêtes hivernales sur la côte Pacifique, tandis qu’il peut retarder la mousson en Inde. En Australie et en Asie du Sud-Est, il accroît les risques de sécheresse et d’incendies. L’Europe, plus indirectement influencée, peut néanmoins subir des répercussions sur ses régimes saisonniers. Si son retour se confirme, El Niño ne serait pas la cause du réchauffement climatique, mais un facteur d’accélération temporaire venant s’ajouter à une tendance de fond déjà préoccupante. Le nouveau « cercle 0 » cible les zones les plus exposées, notamment en Ariège et en Haute-Garonne, avec au moins dix attaques annuelles en moyenne sur trois ans. Il permet un financement à 100 % du gardiennage renforcé pour les structures collectives. Les cercles 1 et 2, relativement stables par rapport à 2025, couvrent respectivement les communes avec indices récents de présence d’ours et une zone tampon préventive. Début février, la préfecture de région Occitanie a publié la liste des communes concernées, rappelant que l’ours, espèce strictement protégée et opportuniste, demeure présent dans le massif pyrénéen.
Le nouveau « cercle 0 » cible les zones les plus exposées, notamment en Ariège et en Haute-Garonne, avec au moins dix attaques annuelles en moyenne sur trois ans. Il permet un financement à 100 % du gardiennage renforcé pour les structures collectives. Les cercles 1 et 2, relativement stables par rapport à 2025, couvrent respectivement les communes avec indices récents de présence d’ours et une zone tampon préventive. Début février, la préfecture de région Occitanie a publié la liste des communes concernées, rappelant que l’ours, espèce strictement protégée et opportuniste, demeure présent dans le massif pyrénéen. Les chiens ont été évalués sur plusieurs critères : quête, rapproche, fermeté sur animal, cohésion de meute et maîtrise de la voix, élément clé dans la chasse au sanglier. Les juges ont souligné la régularité et l’intelligence de chasse des Porcelaines, capables de maintenir une pression constante sur l’animal tout en conservant discipline et coordination. Derrière eux, d’autres équipages réputés ont également livré de belles démonstrations, confirmant le haut niveau national de la chasse aux chiens courants. Organisée tous les quatre ans, à l’image des grandes compétitions sportives internationales, la Coupe de France constitue l’événement phare de la discipline. Elle valorise non seulement les qualités cynégétiques des meutes, mais aussi le savoir-faire des éleveurs et conducteurs. Les vainqueurs savourent désormais un sacre prestigieux qui restera inscrit au palmarès jusqu’à la prochaine édition, programmée en 2030.
Les chiens ont été évalués sur plusieurs critères : quête, rapproche, fermeté sur animal, cohésion de meute et maîtrise de la voix, élément clé dans la chasse au sanglier. Les juges ont souligné la régularité et l’intelligence de chasse des Porcelaines, capables de maintenir une pression constante sur l’animal tout en conservant discipline et coordination. Derrière eux, d’autres équipages réputés ont également livré de belles démonstrations, confirmant le haut niveau national de la chasse aux chiens courants. Organisée tous les quatre ans, à l’image des grandes compétitions sportives internationales, la Coupe de France constitue l’événement phare de la discipline. Elle valorise non seulement les qualités cynégétiques des meutes, mais aussi le savoir-faire des éleveurs et conducteurs. Les vainqueurs savourent désormais un sacre prestigieux qui restera inscrit au palmarès jusqu’à la prochaine édition, programmée en 2030. Créé pour lutter contre l’érosion de la biodiversité, préserver la ressource en eau et accompagner les transitions des usages agricoles et halieutiques, l’OFB se retrouve aujourd’hui au cœur de tensions croissantes. Tags, dépôts de fumier, pneus incendiés devant les locaux, menaces et insultes : selon les syndicats, les agressions se multiplient. Un bâtiment a même été incendié par le passé. Ces actions sont attribuées à une frange du monde agricole meurtrie par les contrôles environnementaux, l’OFB étant désormais perçu comme un organe exclusivement répressif, chargé de sanctionner plutôt que d’accompagner. Une image que contestent les agents, rappelant qu’une large part de leur travail repose sur la pédagogie, le conseil technique et le financement de projets. Les syndicats dénoncent surtout le silence de l’État. Ils affirment que les consignes de maintien de l’ordre auraient conduit à laisser certaines dégradations se produire sans intervention. Ils pointent également l’ouverture d’une enquête sur les modalités de recrutement au sein de l’établissement, vécue comme une remise en cause de leur intégrité professionnelle. Au-delà des tensions ponctuelles, c’est un malaise plus profond qui transparaît : celui d’un établissement qui peine à trouver sa place dans un débat public polarisé, coincé entre attentes sociétales fortes en matière d’environnement et contestation virulente de la ruralité. Les agents disent aujourd’hui travailler « la peur au ventre », dans un climat d’usure morale préoccupant...
Créé pour lutter contre l’érosion de la biodiversité, préserver la ressource en eau et accompagner les transitions des usages agricoles et halieutiques, l’OFB se retrouve aujourd’hui au cœur de tensions croissantes. Tags, dépôts de fumier, pneus incendiés devant les locaux, menaces et insultes : selon les syndicats, les agressions se multiplient. Un bâtiment a même été incendié par le passé. Ces actions sont attribuées à une frange du monde agricole meurtrie par les contrôles environnementaux, l’OFB étant désormais perçu comme un organe exclusivement répressif, chargé de sanctionner plutôt que d’accompagner. Une image que contestent les agents, rappelant qu’une large part de leur travail repose sur la pédagogie, le conseil technique et le financement de projets. Les syndicats dénoncent surtout le silence de l’État. Ils affirment que les consignes de maintien de l’ordre auraient conduit à laisser certaines dégradations se produire sans intervention. Ils pointent également l’ouverture d’une enquête sur les modalités de recrutement au sein de l’établissement, vécue comme une remise en cause de leur intégrité professionnelle. Au-delà des tensions ponctuelles, c’est un malaise plus profond qui transparaît : celui d’un établissement qui peine à trouver sa place dans un débat public polarisé, coincé entre attentes sociétales fortes en matière d’environnement et contestation virulente de la ruralité. Les agents disent aujourd’hui travailler « la peur au ventre », dans un climat d’usure morale préoccupant... Au-delà de sa dimension festive et de la présentation d’animaux emblématiques ou de produits du terroir, le salon demeure un espace de dialogue, de pédagogie et de mise en perspective des mutations en cours. Il met en lumière la diversité des métiers du vivant, les tensions économiques qui traversent les filières, mais aussi leur capacité d’innovation. Dans ce contexte, la forêt occupe une place stratégique, à la croisée des enjeux climatiques, environnementaux et économiques. L’ONF sera une nouvelle fois présent, et à l’occasion de ses 60 ans, l’établissement public proposera un véritable voyage dans le temps pour retracer l’histoire des forêts publiques et rappeler ses missions au service de la gestion durable. Sur son stand, dans une ambiance conviviale et résolument boisée, les visiteurs pourront participer à des quiz, ateliers, jeux pédagogiques et rencontres avec des forestiers. Des conférences aborderont les grands défis de la forêt de demain : rôle de puits de carbone, adaptation au réchauffement, spécificités des forêts d’outre-mer. Une simulation numérique immersive permettra même de projeter l’évolution des massifs forestiers à 25, 50 ou 100 ans...
Au-delà de sa dimension festive et de la présentation d’animaux emblématiques ou de produits du terroir, le salon demeure un espace de dialogue, de pédagogie et de mise en perspective des mutations en cours. Il met en lumière la diversité des métiers du vivant, les tensions économiques qui traversent les filières, mais aussi leur capacité d’innovation. Dans ce contexte, la forêt occupe une place stratégique, à la croisée des enjeux climatiques, environnementaux et économiques. L’ONF sera une nouvelle fois présent, et à l’occasion de ses 60 ans, l’établissement public proposera un véritable voyage dans le temps pour retracer l’histoire des forêts publiques et rappeler ses missions au service de la gestion durable. Sur son stand, dans une ambiance conviviale et résolument boisée, les visiteurs pourront participer à des quiz, ateliers, jeux pédagogiques et rencontres avec des forestiers. Des conférences aborderont les grands défis de la forêt de demain : rôle de puits de carbone, adaptation au réchauffement, spécificités des forêts d’outre-mer. Une simulation numérique immersive permettra même de projeter l’évolution des massifs forestiers à 25, 50 ou 100 ans... Dans ce contexte, la future PAC devra concilier deux impératifs souvent perçus comme contradictoires : renforcer la résilience environnementale tout en préservant la compétitivité des producteurs européens. L’innovation apparaît comme un levier central. Le développement des technologies agricoles, la numérisation, l’amélioration des services de conseil et la montée en compétences des exploitants sont considérés comme essentiels pour accompagner la transition. Des outils économiques adaptés et des règles plus simples et prévisibles sont également jugés indispensables pour garantir la viabilité des exploitations et des territoires ruraux. Au-delà de l’agriculture, la réforme devra accorder une place plus cohérente à la forêt, acteur clé de la stratégie climatique et de la bioéconomie européenne. Les forêts contribuent à l’atténuation du changement climatique, à la protection de la biodiversité, à la production de matériaux renouvelables et à la sécurité énergétique. Elles soutiennent également l’emploi rural et réduisent la dépendance aux énergies fossiles. Pour maintenir cette contribution stratégique, le secteur forestier devra investir dans des technologies modernes, des équipements performants et la formation de professionnels hautement qualifiés. Sans soutien ciblé, il risque de perdre en compétitivité à un moment crucial pour l’Europe. Un événement organisé au Parlement europeen à Bruxelles le 3 mars 2026 mettra en débat ces orientations. L’objectif est de promouvoir une PAC équilibrée, capable d’articuler durabilité, productivité et vitalité rurale, en intégrant pleinement l’avenir de l’agriculture et de la filière forestière dans la stratégie européenne.
Dans ce contexte, la future PAC devra concilier deux impératifs souvent perçus comme contradictoires : renforcer la résilience environnementale tout en préservant la compétitivité des producteurs européens. L’innovation apparaît comme un levier central. Le développement des technologies agricoles, la numérisation, l’amélioration des services de conseil et la montée en compétences des exploitants sont considérés comme essentiels pour accompagner la transition. Des outils économiques adaptés et des règles plus simples et prévisibles sont également jugés indispensables pour garantir la viabilité des exploitations et des territoires ruraux. Au-delà de l’agriculture, la réforme devra accorder une place plus cohérente à la forêt, acteur clé de la stratégie climatique et de la bioéconomie européenne. Les forêts contribuent à l’atténuation du changement climatique, à la protection de la biodiversité, à la production de matériaux renouvelables et à la sécurité énergétique. Elles soutiennent également l’emploi rural et réduisent la dépendance aux énergies fossiles. Pour maintenir cette contribution stratégique, le secteur forestier devra investir dans des technologies modernes, des équipements performants et la formation de professionnels hautement qualifiés. Sans soutien ciblé, il risque de perdre en compétitivité à un moment crucial pour l’Europe. Un événement organisé au Parlement europeen à Bruxelles le 3 mars 2026 mettra en débat ces orientations. L’objectif est de promouvoir une PAC équilibrée, capable d’articuler durabilité, productivité et vitalité rurale, en intégrant pleinement l’avenir de l’agriculture et de la filière forestière dans la stratégie européenne. Deux approches s’opposent classiquement : renforcer la gestion active (réduction de la densité, diversification, limitation des combustibles) ou favoriser la succession naturelle vers des peuplements plus matures et structurellement complexes. Les forêts anciennes, riches en héritages biologiques et en diversité fonctionnelle, sont souvent considérées comme plus résistantes aux perturbations extrêmes. À l’inverse, la gestion active est présentée comme un levier d’adaptation face aux incendies, aux sécheresses ou aux ravageurs. Dans ce contexte, le réseau Natura 2000, pilier de la conservation européenne, offre un terrain d’analyse privilégié. L’étude conduite en Catalogne (1985–2023) a comparé, à partir de données de télédétection, d’inventaires forestiers (3400 placettes) et d’un suivi exhaustif du dépérissement (2012–2023), l’incidence des récoltes, des incendies et de la mortalité liée à la sécheresse à l’intérieur et à l’extérieur des zones protégées. Sur l’ensemble de la période, 20 % des surfaces forestières ont été affectées par des perturbations détectées par satellite, dont 60 % imputables aux récoltes et 40 % aux incendies. Plus récemment, la mortalité due à la sécheresse (11 % entre 2012 et 2023) a atteint une ampleur comparable à quarante années d’incendies cumulés, signalant un impact climatique croissant...
Deux approches s’opposent classiquement : renforcer la gestion active (réduction de la densité, diversification, limitation des combustibles) ou favoriser la succession naturelle vers des peuplements plus matures et structurellement complexes. Les forêts anciennes, riches en héritages biologiques et en diversité fonctionnelle, sont souvent considérées comme plus résistantes aux perturbations extrêmes. À l’inverse, la gestion active est présentée comme un levier d’adaptation face aux incendies, aux sécheresses ou aux ravageurs. Dans ce contexte, le réseau Natura 2000, pilier de la conservation européenne, offre un terrain d’analyse privilégié. L’étude conduite en Catalogne (1985–2023) a comparé, à partir de données de télédétection, d’inventaires forestiers (3400 placettes) et d’un suivi exhaustif du dépérissement (2012–2023), l’incidence des récoltes, des incendies et de la mortalité liée à la sécheresse à l’intérieur et à l’extérieur des zones protégées. Sur l’ensemble de la période, 20 % des surfaces forestières ont été affectées par des perturbations détectées par satellite, dont 60 % imputables aux récoltes et 40 % aux incendies. Plus récemment, la mortalité due à la sécheresse (11 % entre 2012 et 2023) a atteint une ampleur comparable à quarante années d’incendies cumulés, signalant un impact climatique croissant...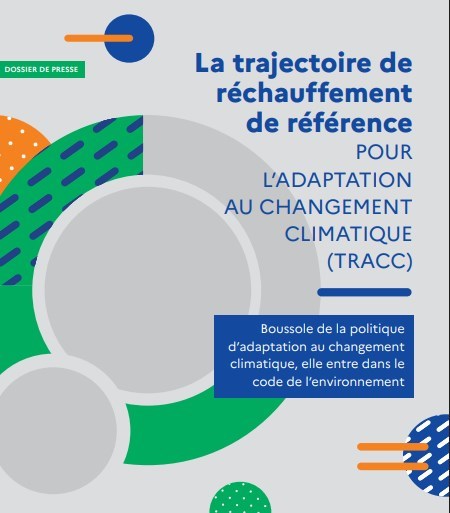 Fondée sur les travaux du GIEC et les projections climatiques disponibles pour la France, la TRACC fixe des hypothèses communes de réchauffement : environ +2 °C dès 2030, +2,7 °C en 2050 et jusqu’à +4 °C à l’horizon 2100 par rapport à l’ère préindustrielle, pour la France hexagonale. En adoptant une trajectoire unique, l’État établit un cadre partagé permettant aux collectivités, aux entreprises et aux citoyens d’évaluer les risques climatiques et d’orienter leurs décisions d’investissement et d’aménagement en fonction du climat futur. Le décret publié le 23 janvier précise les modalités de définition et de mise à jour de cette trajectoire, complété par un arrêté fixant les niveaux de réchauffement retenus. Concrètement, les plans de prévention des risques naturels — inondations, feux de forêt, glissements de terrain — devront être révisés pour intégrer ces projections, ce qui pourra entraîner l’extension de zones inondables ou de nouvelles règles de construction. Les normes techniques encadrant les infrastructures, telles que routes, ponts ou réseaux ferroviaires, évolueront également afin de résister à des conditions climatiques plus extrêmes. En anticipant dès aujourd’hui le climat de demain, la TRACC vise à éviter des reconstructions répétées et coûteuses, tout en protégeant les populations exposées aux canicules, sécheresses ou inondations. Elle constitue à la fois un outil de prévention et une garantie de bonne gestion des finances publiques. Élaborée en concertation avec les élus et soumise à consultation publique, elle s’appuie sur des services climatiques accessibles, notamment les projections locales mises à disposition par Météo-France via la plateforme DRIAS. La TRACC devient ainsi un instrument central pour planifier l’adaptation des territoires et agir avant que les crises ne s’imposent.
Fondée sur les travaux du GIEC et les projections climatiques disponibles pour la France, la TRACC fixe des hypothèses communes de réchauffement : environ +2 °C dès 2030, +2,7 °C en 2050 et jusqu’à +4 °C à l’horizon 2100 par rapport à l’ère préindustrielle, pour la France hexagonale. En adoptant une trajectoire unique, l’État établit un cadre partagé permettant aux collectivités, aux entreprises et aux citoyens d’évaluer les risques climatiques et d’orienter leurs décisions d’investissement et d’aménagement en fonction du climat futur. Le décret publié le 23 janvier précise les modalités de définition et de mise à jour de cette trajectoire, complété par un arrêté fixant les niveaux de réchauffement retenus. Concrètement, les plans de prévention des risques naturels — inondations, feux de forêt, glissements de terrain — devront être révisés pour intégrer ces projections, ce qui pourra entraîner l’extension de zones inondables ou de nouvelles règles de construction. Les normes techniques encadrant les infrastructures, telles que routes, ponts ou réseaux ferroviaires, évolueront également afin de résister à des conditions climatiques plus extrêmes. En anticipant dès aujourd’hui le climat de demain, la TRACC vise à éviter des reconstructions répétées et coûteuses, tout en protégeant les populations exposées aux canicules, sécheresses ou inondations. Elle constitue à la fois un outil de prévention et une garantie de bonne gestion des finances publiques. Élaborée en concertation avec les élus et soumise à consultation publique, elle s’appuie sur des services climatiques accessibles, notamment les projections locales mises à disposition par Météo-France via la plateforme DRIAS. La TRACC devient ainsi un instrument central pour planifier l’adaptation des territoires et agir avant que les crises ne s’imposent. Ces résultats s’inscrivent dans un contexte global de déclin des populations : selon l’Union internationale pour la conservation de la nature, 61 % des espèces d’oiseaux présentaient une tendance démographique négative en octobre dernier, contre 44 % en 2016. L’étude montre que l’augmentation du bruit ambiant interfère directement avec les signaux acoustiques essentiels à la communication intra-spécifique. Le chant, qui joue un rôle central dans l’attraction des partenaires et la défense du territoire, est masqué par les fréquences générées par les infrastructures humaines. Certaines espèces, notamment le rouge-gorge, apparaissent particulièrement sensibles à cette interférence. Les observations réalisées durant les périodes de réduction d’activité humaine ont confirmé une amélioration de la détectabilité des vocalisations. Face à cette contrainte acoustique, les oiseaux adoptent des stratégies compensatoires : augmentation de l’intensité vocale, allongement de la durée d’émission ou modification fréquentielle vers des tonalités plus aiguës. Ces ajustements entraînent un coût énergétique supplémentaire susceptible d’affecter la condition physique des individus. Par ailleurs, la pollution lumineuse agit conjointement en altérant les rythmes circadiens, provoquant notamment des vocalisations nocturnes inhabituelles en milieu urbain. Les auteurs suggèrent plusieurs mesures d’atténuation, telles que l’adaptation des matériaux de construction, la réduction des nuisances sonores durant les périodes critiques de reproduction et de migration, ainsi que le recours à des technologies moins bruyantes.
Ces résultats s’inscrivent dans un contexte global de déclin des populations : selon l’Union internationale pour la conservation de la nature, 61 % des espèces d’oiseaux présentaient une tendance démographique négative en octobre dernier, contre 44 % en 2016. L’étude montre que l’augmentation du bruit ambiant interfère directement avec les signaux acoustiques essentiels à la communication intra-spécifique. Le chant, qui joue un rôle central dans l’attraction des partenaires et la défense du territoire, est masqué par les fréquences générées par les infrastructures humaines. Certaines espèces, notamment le rouge-gorge, apparaissent particulièrement sensibles à cette interférence. Les observations réalisées durant les périodes de réduction d’activité humaine ont confirmé une amélioration de la détectabilité des vocalisations. Face à cette contrainte acoustique, les oiseaux adoptent des stratégies compensatoires : augmentation de l’intensité vocale, allongement de la durée d’émission ou modification fréquentielle vers des tonalités plus aiguës. Ces ajustements entraînent un coût énergétique supplémentaire susceptible d’affecter la condition physique des individus. Par ailleurs, la pollution lumineuse agit conjointement en altérant les rythmes circadiens, provoquant notamment des vocalisations nocturnes inhabituelles en milieu urbain. Les auteurs suggèrent plusieurs mesures d’atténuation, telles que l’adaptation des matériaux de construction, la réduction des nuisances sonores durant les périodes critiques de reproduction et de migration, ainsi que le recours à des technologies moins bruyantes. Les discussions ont porté sur trois axes étroitement liés : la résilience face au changement climatique et à la crise de l’eau, le rôle de l’UE dans les négociations climatiques internationales et la transition vers une économie circulaire compétitive. En amont de la réunion, les ministres ont participé à une visite de terrain dans le parc communautaire de Delikipos, où leur a été présentée une méthode innovante de mesure de la séquestration du carbone par les arbres. Cette initiative a illustré l’importance de la science, de l’innovation et de la transparence des données pour soutenir des politiques climatiques crédibles. Lors de la première session de travail, les ministres ont examiné les moyens de mieux coordonner les politiques, la législation et les financements européens afin de renforcer la résilience climatique et hydrique. Ils ont souligné l’impact croissant du changement climatique sur l’économie et la sécurité, notamment à travers la raréfaction de l’eau, et la nécessité d’une approche cohérente intégrant les niveaux européen et national, avec une attention particulière portée aux régions les plus vulnérables. La deuxième session a été consacrée à l’efficacité de l’Union européenne dans les négociations internationales sur le climat. Les participants ont tiré les enseignements des dernières conférences des parties (COP) et ont insisté sur l’importance d’une diplomatie climatique plus stratégique, fondée sur la coordination, la formation précoce de coalitions et l’utilisation cohérente des instruments de politique extérieure de l’UE. Enfin, les ministres ont débattu des perspectives de la future réglementation sur l’économie circulaire et des mesures européennes en matière d’énergie. Ils ont mis en avant le rôle central de l’économie circulaire pour renforcer la compétitivité, réduire les dépendances stratégiques et soutenir la résilience de l’Union. La réunion s’est conclue par un large consensus sur la nécessité d’une action européenne coordonnée, alignant ambitions et mise en œuvre, afin de renforcer simultanément la crédibilité mondiale, la compétitivité et la résilience de l’Europe.
Les discussions ont porté sur trois axes étroitement liés : la résilience face au changement climatique et à la crise de l’eau, le rôle de l’UE dans les négociations climatiques internationales et la transition vers une économie circulaire compétitive. En amont de la réunion, les ministres ont participé à une visite de terrain dans le parc communautaire de Delikipos, où leur a été présentée une méthode innovante de mesure de la séquestration du carbone par les arbres. Cette initiative a illustré l’importance de la science, de l’innovation et de la transparence des données pour soutenir des politiques climatiques crédibles. Lors de la première session de travail, les ministres ont examiné les moyens de mieux coordonner les politiques, la législation et les financements européens afin de renforcer la résilience climatique et hydrique. Ils ont souligné l’impact croissant du changement climatique sur l’économie et la sécurité, notamment à travers la raréfaction de l’eau, et la nécessité d’une approche cohérente intégrant les niveaux européen et national, avec une attention particulière portée aux régions les plus vulnérables. La deuxième session a été consacrée à l’efficacité de l’Union européenne dans les négociations internationales sur le climat. Les participants ont tiré les enseignements des dernières conférences des parties (COP) et ont insisté sur l’importance d’une diplomatie climatique plus stratégique, fondée sur la coordination, la formation précoce de coalitions et l’utilisation cohérente des instruments de politique extérieure de l’UE. Enfin, les ministres ont débattu des perspectives de la future réglementation sur l’économie circulaire et des mesures européennes en matière d’énergie. Ils ont mis en avant le rôle central de l’économie circulaire pour renforcer la compétitivité, réduire les dépendances stratégiques et soutenir la résilience de l’Union. La réunion s’est conclue par un large consensus sur la nécessité d’une action européenne coordonnée, alignant ambitions et mise en œuvre, afin de renforcer simultanément la crédibilité mondiale, la compétitivité et la résilience de l’Europe.