 Si le premier déchirement avec la sérénité de sa jeunesse s’opère dans les salles d’étude de la prestigieuse école de la rue d’Ulm, le second traumatisme sera bien sûr l’expérience de la guerre totale, où les gerbes d’obus labourent la terre et la rendent stérile. Aussi, après le conflit, il revient vivre au creux des méandres de la Loire paisible. Il s’attache à peindre des êtres en accord profond avec ce pays secret et austère qu’est la Sologne. La récompense du prix Goncourt lui permet d’acheter la Vernelles, « vieille maison pleine d’histoire et souriante de ses secrets » comme nous les aimons tant. C’est face à la Loire, dans cette commune de Saint Denis de l’Hôtel, qu’il écrira ses œuvres. Genevoix est habile dans l’innombrable toucher de cet espace familier, car vivant de plain-pied avec le mystère des bois et des étangs. C’est là qu’existent, et se meuvent dans le mystère des bois et des étangs, des êtres simples aux fortes
Si le premier déchirement avec la sérénité de sa jeunesse s’opère dans les salles d’étude de la prestigieuse école de la rue d’Ulm, le second traumatisme sera bien sûr l’expérience de la guerre totale, où les gerbes d’obus labourent la terre et la rendent stérile. Aussi, après le conflit, il revient vivre au creux des méandres de la Loire paisible. Il s’attache à peindre des êtres en accord profond avec ce pays secret et austère qu’est la Sologne. La récompense du prix Goncourt lui permet d’acheter la Vernelles, « vieille maison pleine d’histoire et souriante de ses secrets » comme nous les aimons tant. C’est face à la Loire, dans cette commune de Saint Denis de l’Hôtel, qu’il écrira ses œuvres. Genevoix est habile dans l’innombrable toucher de cet espace familier, car vivant de plain-pied avec le mystère des bois et des étangs. C’est là qu’existent, et se meuvent dans le mystère des bois et des étangs, des êtres simples aux fortes 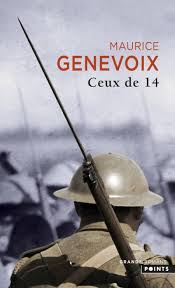 passions. Genevoix est en communion avec les bêtes, ce qui sera le thème de Rroû (1931) et maîtrise la poésie sauvage qui nait de la lutte entre les animaux et l’homme (la Dernière Harde, 1938). Nous y lisons la quête secrète conflictuelle et passionnée qui s’anime dans chaque homme, et qui se cristallisent dans la passion de la chasse. La chasse qui est une quête plus que le désir de tuer. Dans son œuvre, que l’on ne peut classer dans la veine régionaliste, l’écrivain est une sorte de chaman qui vit en symbiose avec le monde animal. La carrière littéraire de Maurice Genevoix est une grande réussite, avec sa consécration à l’élection de l’Académie Française. C’est un écrivain reconnu et couvert d’honneurs qui s’est beaucoup investi dans la défense internationale de la langue française. Aussi, nous ne retiendrons que deux œuvres capitales qui permettent à Genevoix d’entrer dans la liste des écrivains cynégétiques : Raboliot et le Dernière Harde.
passions. Genevoix est en communion avec les bêtes, ce qui sera le thème de Rroû (1931) et maîtrise la poésie sauvage qui nait de la lutte entre les animaux et l’homme (la Dernière Harde, 1938). Nous y lisons la quête secrète conflictuelle et passionnée qui s’anime dans chaque homme, et qui se cristallisent dans la passion de la chasse. La chasse qui est une quête plus que le désir de tuer. Dans son œuvre, que l’on ne peut classer dans la veine régionaliste, l’écrivain est une sorte de chaman qui vit en symbiose avec le monde animal. La carrière littéraire de Maurice Genevoix est une grande réussite, avec sa consécration à l’élection de l’Académie Française. C’est un écrivain reconnu et couvert d’honneurs qui s’est beaucoup investi dans la défense internationale de la langue française. Aussi, nous ne retiendrons que deux œuvres capitales qui permettent à Genevoix d’entrer dans la liste des écrivains cynégétiques : Raboliot et le Dernière Harde.
Raboliot, l’incorrigible braconnier…
Le gaillard et subtil Raboliot est harcelé par les gardes du Saint Hubert, et surtout par la haine du gendarme Bourrel. Longtemps, il a dû se terrer, puis se réfugier dans les bois, comme une bête sauvage. Malgré cela, le besoin de retrouver la chaleur de son couple et de ses enfants le fera tomber dans un piège. Mais le vrai couple, c’est celui que forme Raboliot et sa chienne : « Nous n’allons pas aux canards, Aïcha… ». Elle avait compris ! Toutes ces pages développent une sombre puissance, mais dénotent la nature vraie des instincts de Raboliot. Ce livre de chasse s’ouvre sur la scène de vidange des étangs. Nos pas s’enchâssent dans ceux de Raboliot, au long des berges lumineuses, des bois de pins bleus et de clairs bouleaux de la Sologne. Dans la Dernière Harde, la nature reste la plus forte et sélectionne l’être le plus apte à poursuivre le combat : le cerf. Le « Rouge » fait ses classes face au chevrillard teigneux, au sanglier massif et de force brute, au cerf pèlerin au jarret d’acier. Tout le décor semble sorti des livres anciens sur la forêt gauloise où « le sacré nait de sa propre différence ». Grenou est rongé du désir démoniaque du sang mauvais. Il ne laisse aucune chance au gibier et ne distingue plus la biche reproductrice du cerf étalon. Ce tueur se rue le gourdin haut : « la joie de tuer lui salissait les yeux, une laideur qui faisait mal à regarder ». A l’opposé, La Futaie est un noble qui « s’avançait, sans menace, irrésistible… Mais il y avait la voix, son timbre brave et sa vibration profonde ». Autour des trois cycles de la vie du Rouge, s’enroulent ceux des chiens : Tapageault remplace Ronflaut. La dernière chasse s’engage sur deux jours. Le piqueux sait qu’il va poursuivre une bête invisible sur ses voies de forlonger… A la fin, ce n’est pas le piqueux qui sert l’animal, c’est une sorte de seppuku où le cerf lui–même accepte l’issue et prend la mort de lui-même : « Le Rouge s’est penché en avant… Il a poussé sa poitrine profonde contre la pointe qui le touchait… ». Enfin, le respect et la compréhension de la nature non domestiquée, quand Le Rouge fuit pour le brame, la complicité du chasseur et de son chien soumis, sont les critères d’une 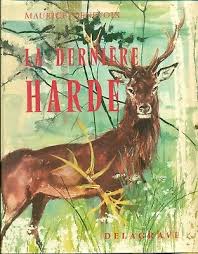 écriture de chasse. Genevoix n’abuse pas du langage technique qui étoufferait la poésie de sa prose, mais il reconnait la saveur de la langue de vènerie, « vive et d’aloi franc ». « Si les animaux disparaissaient, l’homme serait encore plus étranger à lui–même ». Il n’est pas question, bien sûr, de l’animal robotisé en batterie ni de l’animal domestique, véritable zombie dans notre jungle urbaine. L’œuvre de Genevoix est une longue méditation sur la nécessité de pénétrer par le cœur dans les ressorts de la vie animale. Elle est donc toujours d’urgence pour nous démarquer, suivant ce passage où d’autres calendriers officiels nous commandent et nous imposent des jours de chasse. « Mais ce besoin de chasse nocturne qui vous empoignait tout à coup, parce qu’il pleuvinait dans les ténèbres, parce qu’il faisait clair de lune, parce qu’il avait neigé… Voilà, tous ces gens ne savent pas… ». Lisons donc ou relisons Genevoix qui nous encourage à une chasse respectueuse.
écriture de chasse. Genevoix n’abuse pas du langage technique qui étoufferait la poésie de sa prose, mais il reconnait la saveur de la langue de vènerie, « vive et d’aloi franc ». « Si les animaux disparaissaient, l’homme serait encore plus étranger à lui–même ». Il n’est pas question, bien sûr, de l’animal robotisé en batterie ni de l’animal domestique, véritable zombie dans notre jungle urbaine. L’œuvre de Genevoix est une longue méditation sur la nécessité de pénétrer par le cœur dans les ressorts de la vie animale. Elle est donc toujours d’urgence pour nous démarquer, suivant ce passage où d’autres calendriers officiels nous commandent et nous imposent des jours de chasse. « Mais ce besoin de chasse nocturne qui vous empoignait tout à coup, parce qu’il pleuvinait dans les ténèbres, parce qu’il faisait clair de lune, parce qu’il avait neigé… Voilà, tous ces gens ne savent pas… ». Lisons donc ou relisons Genevoix qui nous encourage à une chasse respectueuse.
Extrait de « Raboliot »
Ce passage est caractéristique de la sobre puissance d’écriture de Genevoix. C’est un mélange de cruauté et de véracité. Dans cette page, nulle odeur de poudre, nul cri de chasse. Tout est étouffé, amorti dans la nuit solognote. Seuls le sens tactile et l’ouïe de Raboliot sont en œuvre dans cette course ténébreuse qui se joue entre les lapins apeurés et la chienne Aïcha, l’auxiliaire indispensable de Raboliot.
Une chasse nocturne
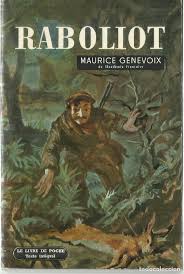 Ce fut une bonne marche que celle-là dans la nuit longue et fraîche où brillait le soleil des loups. Une nuit d’or, mon Aïcha, parce qu’il faisait clair de lune. Mais pour un vrai braconnier les nuits d’or sont nombreuses l’hiver. Cela dépend du flair de l’homme, de sa souplesse à saisir en chaque nuit la complicité qu’elle lui offre. Noire et venteuse, elle aurait appelé le falot du lanternier. Brumeuse et pâle, bruissante de pluie fine sur la jonchée des feuilles, elle aurait gardé le chasseur vers les grands arbres où les faisans perchés posent des ronds noirs sur les branches. Neigeuse, elle aurait conduit à la lisière de quelques bois, en telle place de bon affût d’où l’on voit les lapins et les lièvres boultiner, affamés sur la friche blanche…
Ce fut une bonne marche que celle-là dans la nuit longue et fraîche où brillait le soleil des loups. Une nuit d’or, mon Aïcha, parce qu’il faisait clair de lune. Mais pour un vrai braconnier les nuits d’or sont nombreuses l’hiver. Cela dépend du flair de l’homme, de sa souplesse à saisir en chaque nuit la complicité qu’elle lui offre. Noire et venteuse, elle aurait appelé le falot du lanternier. Brumeuse et pâle, bruissante de pluie fine sur la jonchée des feuilles, elle aurait gardé le chasseur vers les grands arbres où les faisans perchés posent des ronds noirs sur les branches. Neigeuse, elle aurait conduit à la lisière de quelques bois, en telle place de bon affût d’où l’on voit les lapins et les lièvres boultiner, affamés sur la friche blanche…
C’était là, juste au-dessus des bassins de tri : un grand champ de mauvaise culture, envahi d’herbes, où l’on avait laissé pourrir quelques fanes de sarrasin. Il enfourcha la clôture et, pour aller plus vite, passa Aïcha dans ses bras ; elle frémissait, les narines battantes :
- Allez, Allez !
Il l’avait lâchée ; elle était partie à fond de train, galopant le long du grillage. Il y eut aussitôt, en tous sens, des piétinements menus, affolés, et du coup un choc grattant de griffes, un cri effilé, suraigu. Raboliot marcha vers sa chienne, noire et boulée contre le treillis, les ongles plantés raides en terre, un lapin pantelant dans la gueule.
- Allez, Allez !
Aïcha desserra les mâchoires. Elle repartait déjà pendant que Raboliot, pattes d’une main, oreilles de l’autre, disloquait d’une traction appuyée la colonne vertébrale du lapin. Et dans l’instant cela recommença : les fuites désordonnées, le choc sourd de la chienne se ruant contre le grillage, freinant des pattes et labourant le sol et le cri suraigu du lapin capturé. Raboliot ne courrait pas : il avait fort à faire pour soutenir l’allure d’Aïcha ; mais il prévoyait à chaque fois le point juste où elle allait bondir ; dès que les crocs entraient dans le poil, la main de Raboliot était là. Dans sa musette de toile, les petits cadavres chauds s’amoncelaient ; la bretelle commençait à lui tirer fort sur la nuque.
- Allez, Allez !
Une nuit d’or, une besogne bien faite ! La noire avait le diable dans la peau. Etrangement muette, elle virevoltait, fonçait soudain en flèche vertigineuse, bondissait à travers le champ comme un ténébreux feu-follet. De temps en temps, par-dessus l’épaule, Raboliot regardait vers l’ouest, vers la maison du garde et le bois de la Sauvagère. Et cependant ses mains n’arrêtaient pas de travailler, arrachaient à la gueule d’Aïcha les lapins qui gigotaient, empoignaient les oreilles et les pattes, et tiraient : les vertèbres fragiles craquaient, la bête pesait, inerte et molle, comme une loque tiède. Au sac ! Il y en avait déjà sept ou huit, et la noire galopait toujours, et Raboliot l’encourageait toujours, d’une voix basse et pressante, poussée raide entre les dents.
- Allez, Allez !
Contre sa hanche, le grillage, quelquefois, tremblait. Les petits cris, pointus comme vrille, retentissaient de ça de là. Et, Raboliot murmurait, exultant : « Si ça couine, bond’là, si ça couine ! ». Qu’est-ce qu’il y avait, qu’est-ce qu‘il pouvait y avoir de meilleur au monde ? Il chassait dans la nuit, avec pour compagnon le halètement chaud d’Aïcha, sa forme ardente et sombre et ses bonds meurtriers. Chaque piaulement de détresse lui pénétrait au fond de l’être, lui faisait basculer le cœur. Au sac, au sac ! Il gardait contre ses paumes la sensation de ce poil palpitant, il continuait d’entendre le craquement de ces os grêles, d’éprouver dans sa chair le petit déclenchement qui les disloquait tout à coup, les arrachait les uns des autres. De la joie ? C’était bien autre chose ! Une soûlerie capiteuse, un vertige de bonheur qui lui enflait la poitrine, qui lui montait en rire dans la gorge. Et les gaillards, là-bas, qui fouillaient les taillis de la Sauvagère ! Demain matin, pas plus tard, ils verraient dans ce champ les empreintes d’une vaillante petite chienne, les traces griffues de ses élans, - allez donc, allez, Aïcha !- et des touffes de poils gris collées encore aux mailles du grillage. « Et c’est moi qui suis venu ; c’est bien moi, moi, Raboliot ; mais va-t’en voir demain si je reviens, Volat ! ».
Au lointain du bois, vers l’ouest, un jappement rauque éclata tout à coup, se brisa en glapissement de chien battu. Raboliot riait : « Des chiens, Ils appellent ça des chiens ! ». Sa  main flattait les longs poils d’Aïcha, ses flancs moites qui haletaient : « Nous en avons pris douze, ma belle ! Nous avons rudement bien travaillé ! ». Elle levait vers lui sa tête fine, ses yeux tendres, mouillés d’amitié. Il lui abandonna ses mains, les lui laissa lécher un instant.
main flattait les longs poils d’Aïcha, ses flancs moites qui haletaient : « Nous en avons pris douze, ma belle ! Nous avons rudement bien travaillé ! ». Elle levait vers lui sa tête fine, ses yeux tendres, mouillés d’amitié. Il lui abandonna ses mains, les lui laissa lécher un instant.
- En route !
Il allait à présent, au plus vite, gagner la ferme du Bois-Sabot. Il réveillerait Berlaisier, Sarcelotte, et leur dirait les mots qu’il fallait dire. Pour Aïcha, un seul mot suffirait, rien qu’une syllabe, chuchotée en lui montrant la route : « Va ! ». Et elle rentrerait seule, poussée par l’ordre du maître : elle avait l’habitude ; dans un quart d’heure, elle serait à sa niche…
