L’Office international de l’eau et le Pôle-relais lagunes méditerranéennes organisent, dans le cadre du centre de ressources sur les milieux humides et avec le soutien de l’OFB, une webconférence intitulée : « Des milieux humides et des chiffres », qui se tiendra le mardi 9 décembre, de 14h à 16h (heure de Paris). Cette rencontre en ligne s’inscrit dans la continuité de la fiche 29 du 4e Plan national en faveur des milieux humides, qui prévoit de « documenter les impacts, les pressions, l’état et les actions menées sur ces milieux en renforçant leur intégration dans les Observatoires de la biodiversité ».  Dans cette optique, le groupe technique « Milieux humides » de l’Observatoire national de la biodiversité (ONB), élabore actuellement des indicateurs permettant d’évaluer la santé et l’évolution de ces écosystèmes fragiles, soumis à de multiples pressions humaines et au changement climatique. Parallèlement, de nombreux Observatoires territoriaux de la biodiversité (OTB) se développent à différentes échelles, régionales, départementales, intercommunales ou encore à l’échelle des parcs naturels. Portés par des structures diverses (collectivités, établissements publics, associations, etc.), ces observatoires contribuent activement à la valorisation et au partage des connaissances sur la biodiversité locale. Leurs approches variées constituent un atout majeur pour renforcer la compréhension des dynamiques écologiques à l’échelle des territoires. Cette webconférence vise à répondre à plusieurs questions essentielles :
Dans cette optique, le groupe technique « Milieux humides » de l’Observatoire national de la biodiversité (ONB), élabore actuellement des indicateurs permettant d’évaluer la santé et l’évolution de ces écosystèmes fragiles, soumis à de multiples pressions humaines et au changement climatique. Parallèlement, de nombreux Observatoires territoriaux de la biodiversité (OTB) se développent à différentes échelles, régionales, départementales, intercommunales ou encore à l’échelle des parcs naturels. Portés par des structures diverses (collectivités, établissements publics, associations, etc.), ces observatoires contribuent activement à la valorisation et au partage des connaissances sur la biodiversité locale. Leurs approches variées constituent un atout majeur pour renforcer la compréhension des dynamiques écologiques à l’échelle des territoires. Cette webconférence vise à répondre à plusieurs questions essentielles :
- comment les indicateurs nationaux sur les milieux humides peuvent-ils être mobilisés pour répondre aux besoins spécifiques des territoires ?
- quel rôle concret jouent les Observatoires territoriaux de la biodiversité dans la collecte, l’analyse et la diffusion des données ?
Le programme prévisionnel de la rencontre comprendra : - Une présentation générale de l’ONB et des OTB ; - Un point d’étape sur les indicateurs nationaux des milieux humides, adaptés à différents niveaux territoriaux ; - Le témoignage de l’Office de l’Environnement de Corse ; - L’intervention d’un second observatoire territorial (à confirmer) ; - Un temps d’échanges ouvert avec les participants. Cette webconférence constitue une occasion privilégiée de mieux comprendre les outils de suivi de la biodiversité, de partager les expériences locales et de contribuer à l’évolution des indicateurs dédiés aux milieux humides.

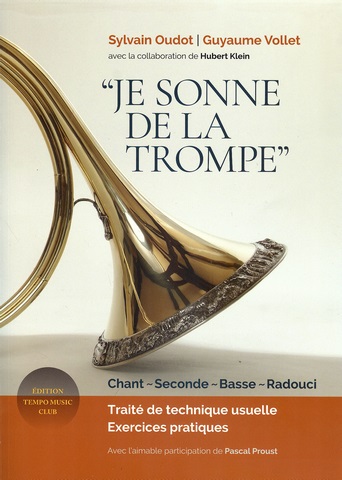
 Cette classification souligne son potentiel destructeur : en cas de prolifération, il pourrait avoir un impact majeur sur les forêts françaises. En conséquence, sa détection entraîne automatiquement la mise en œuvre de mesures de lutte obligatoires destinées à éradiquer le foyer et à empêcher toute dissémination. Le nématode du pin attaque principalement les conifères, et tout particulièrement les pins. Il s’introduit dans les tissus de l’arbre, bloque la circulation de la sève et provoque ainsi la mort rapide des sujets infestés. Le parasite se déplace d’un arbre à l’autre grâce à certains coléoptères vecteurs, responsables de la propagation de la maladie. À ce jour, il ne présente aucun danger pour la santé humaine ou animale, mais constitue une menace sérieuse pour l’équilibre des écosystèmes forestiers. Face à cette découverte inédite sur le territoire national, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a décidé de réunir sans délai l’ensemble des acteurs concernés (services de l’État, collectivités, filière forestière et experts scientifiques) afin de définir un plan d’action immédiat. Celui-ci visera à prévenir la propagation du nématode vers d’autres massifs forestiers, notamment par des restrictions de circulation du bois et des contrôles renforcés. Ce parasite avait déjà été détecté en Europe : d’abord au Portugal en 1999, puis en Espagne en 2008, où il a provoqué des pertes considérables dans les forêts de pins. Jusqu’à présent, la France était restée épargnée grâce à des programmes de surveillance et de prévention rigoureux. Cette première détection marque donc un tournant majeur pour la protection des forêts françaises et mobilise pleinement les autorités afin de préserver durablement le patrimoine sylvicole national.
Cette classification souligne son potentiel destructeur : en cas de prolifération, il pourrait avoir un impact majeur sur les forêts françaises. En conséquence, sa détection entraîne automatiquement la mise en œuvre de mesures de lutte obligatoires destinées à éradiquer le foyer et à empêcher toute dissémination. Le nématode du pin attaque principalement les conifères, et tout particulièrement les pins. Il s’introduit dans les tissus de l’arbre, bloque la circulation de la sève et provoque ainsi la mort rapide des sujets infestés. Le parasite se déplace d’un arbre à l’autre grâce à certains coléoptères vecteurs, responsables de la propagation de la maladie. À ce jour, il ne présente aucun danger pour la santé humaine ou animale, mais constitue une menace sérieuse pour l’équilibre des écosystèmes forestiers. Face à cette découverte inédite sur le territoire national, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a décidé de réunir sans délai l’ensemble des acteurs concernés (services de l’État, collectivités, filière forestière et experts scientifiques) afin de définir un plan d’action immédiat. Celui-ci visera à prévenir la propagation du nématode vers d’autres massifs forestiers, notamment par des restrictions de circulation du bois et des contrôles renforcés. Ce parasite avait déjà été détecté en Europe : d’abord au Portugal en 1999, puis en Espagne en 2008, où il a provoqué des pertes considérables dans les forêts de pins. Jusqu’à présent, la France était restée épargnée grâce à des programmes de surveillance et de prévention rigoureux. Cette première détection marque donc un tournant majeur pour la protection des forêts françaises et mobilise pleinement les autorités afin de préserver durablement le patrimoine sylvicole national. Cette réunion se déroulera en présence de Matthieu Lefèvre, ministre délégué chargé de la Transition écologique. Monique Barbut, ancienne dirigeante du WWF France apporte un profil atypique pour ce poste : son expérience dans les ONG environnementales et sur la scène internationale lui confère une expertise solide sur la biodiversité, les négociations climatiques et la gestion durable des territoires. Cette expérience pourrait favoriser un climat constructif et la recherche de synergies entre la chasse et la protection de la nature. Pour Willy Schraen, l’entretien constitue une opportunité de présenter les pratiques de chasse responsables et de discuter de leur articulation avec les politiques environnementales. Les échanges devraient aborder plusieurs axes : la réglementation, la conservation des espèces et des habitats menacés, et la cohabitation entre chasseurs, agriculteurs et acteurs de la biodiversité. L’évaluation des initiatives existantes et la promotion de programmes de sensibilisation à la préservation de la nature devraient également figurer au cœur des discussions.
Cette réunion se déroulera en présence de Matthieu Lefèvre, ministre délégué chargé de la Transition écologique. Monique Barbut, ancienne dirigeante du WWF France apporte un profil atypique pour ce poste : son expérience dans les ONG environnementales et sur la scène internationale lui confère une expertise solide sur la biodiversité, les négociations climatiques et la gestion durable des territoires. Cette expérience pourrait favoriser un climat constructif et la recherche de synergies entre la chasse et la protection de la nature. Pour Willy Schraen, l’entretien constitue une opportunité de présenter les pratiques de chasse responsables et de discuter de leur articulation avec les politiques environnementales. Les échanges devraient aborder plusieurs axes : la réglementation, la conservation des espèces et des habitats menacés, et la cohabitation entre chasseurs, agriculteurs et acteurs de la biodiversité. L’évaluation des initiatives existantes et la promotion de programmes de sensibilisation à la préservation de la nature devraient également figurer au cœur des discussions.  À moyen terme, cet entretien pourrait avoir des retombées concrètes et stratégiques.
À moyen terme, cet entretien pourrait avoir des retombées concrètes et stratégiques.  Cette année, le spectacle majestueux de leur halte migratoire a laissé place à l’épizootie de grippe aviaire dont le virus, hautement pathogène et extrêmement contagieux entre oiseaux, décime les populations à une vitesse alarmante. Les grues, affaiblies, désorientées, s’effondrent parfois sur les berges ou meurent en plein vol. Si cette souche d’influenza aviaire ne se transmet pas à l’homme ni aux mammifères, elle menace gravement les équilibres écologiques et la filière avicole locale. Dans la Marne et la Haute-Marne, la faune sauvage comme les élevages sont désormais placés sous haute surveillance. Face à cette situation dramatique, les autorités locales, les associations naturalistes et les communes se sont mobilisées. Des zones de confinement ont été instaurées autour des principaux foyers. Des bacs de récupération d’oiseaux morts ont été mis en place, et les habitants sont appelés à la plus grande vigilance : ne pas manipuler les carcasses, signaler toute découverte aux services vétérinaires, et, en cas d’intervention nécessaire, se protéger avec masque, gants et sacs plastiques. L’objectif : éviter toute propagation supplémentaire. Mais malgré ces mesures strictes, l’inquiétude grandit chez les éleveurs. Les pertes économiques et le traumatisme psychologique sont considérables dans un secteur déjà fragilisé par les précédentes vagues de grippe aviaire. À Montier-en-Der, le célèbre festival international de la photo animalière, prévu dans les prochains jours, pourrait lui aussi être affecté. Des restrictions de déplacement et des zones interdites d’accès ont été instaurées. Les organisateurs et naturalistes redoutent que cette catastrophe écologique ne bouleverse durablement les migrations à venir.
Cette année, le spectacle majestueux de leur halte migratoire a laissé place à l’épizootie de grippe aviaire dont le virus, hautement pathogène et extrêmement contagieux entre oiseaux, décime les populations à une vitesse alarmante. Les grues, affaiblies, désorientées, s’effondrent parfois sur les berges ou meurent en plein vol. Si cette souche d’influenza aviaire ne se transmet pas à l’homme ni aux mammifères, elle menace gravement les équilibres écologiques et la filière avicole locale. Dans la Marne et la Haute-Marne, la faune sauvage comme les élevages sont désormais placés sous haute surveillance. Face à cette situation dramatique, les autorités locales, les associations naturalistes et les communes se sont mobilisées. Des zones de confinement ont été instaurées autour des principaux foyers. Des bacs de récupération d’oiseaux morts ont été mis en place, et les habitants sont appelés à la plus grande vigilance : ne pas manipuler les carcasses, signaler toute découverte aux services vétérinaires, et, en cas d’intervention nécessaire, se protéger avec masque, gants et sacs plastiques. L’objectif : éviter toute propagation supplémentaire. Mais malgré ces mesures strictes, l’inquiétude grandit chez les éleveurs. Les pertes économiques et le traumatisme psychologique sont considérables dans un secteur déjà fragilisé par les précédentes vagues de grippe aviaire. À Montier-en-Der, le célèbre festival international de la photo animalière, prévu dans les prochains jours, pourrait lui aussi être affecté. Des restrictions de déplacement et des zones interdites d’accès ont été instaurées. Les organisateurs et naturalistes redoutent que cette catastrophe écologique ne bouleverse durablement les migrations à venir.