Un décret publié au Journal officiel le 4 février 2026 modifie en profondeur les règles d’indemnisation des dommages causés aux troupeaux domestiques par le loup. Le décret n° 2026-53 du 3 février 2026 vient ainsi modifier le décret n° 2019-722 du 9 juillet 2019, en étendant la conditionnalité de l’indemnisation aux exploitations situées en cercle 2, c’est-à-dire dans les zones où la prédation est jugée possible au cours de l’année. Jusqu’à présent, le dispositif distinguait plusieurs niveaux de zonage. Le cercle 0 correspond aux foyers de prédation avérée, tandis que le cercle 1 recouvre les zones de présence permanente du loup.  Dans ces secteurs, l’indemnisation des dommages était déjà conditionnée à la mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens de protection, parcs électrifiés, gardiennage renforcé, etc.). En revanche, les exploitations situées en cercle 2, souvent qualifiées de front de colonisation, pouvaient être indemnisées sans obligation préalable de protection, en raison du caractère émergent ou incertain du risque. Le nouveau décret met fin à cette distinction. Désormais, dans les zones classées en cercle 2, le versement des indemnisations sera conditionné à la mise en œuvre effective de moyens de protection au-delà de la deuxième attaque reconnue au cours de l’année. Autrement dit, les deux premières attaques restent indemnisables sans exigence de protection préalable, mais toute attaque ultérieure ne donnera lieu à indemnisation que si l’éleveur a engagé des mesures de prévention adaptées. Cette évolution marque un tournant dans la politique de gestion du risque de prédation. Elle vise à encourager l’anticipation et la généralisation progressive des dispositifs de protection dans les territoires en phase de colonisation, tout en tenant compte des difficultés techniques et économiques rencontrées par les éleveurs lors des premières attaques. Le décret apporte également une clarification terminologique importante. Jusqu’ici, certaines décisions d’indemnisation faisaient principalement référence à la mortalité des animaux. Le nouveau texte élargit explicitement le champ des indemnisations à l’ensemble des dommages subis par les troupeaux, incluant désormais les blessures, en cohérence avec la réalité des impacts économiques et sanitaires pour les exploitations. Cette réforme s’inscrit dans un contexte de progression géographique du loup et de tensions croissantes entre objectifs de conservation de l’espèce et viabilité des systèmes d’élevage extensifs. Elle renforce la logique de responsabilité partagée entre l’État et les éleveurs, en faisant de la prévention un préalable de plus en plus central à l’accès à l’indemnisation publique.
Dans ces secteurs, l’indemnisation des dommages était déjà conditionnée à la mise en place préalable de mesures de protection des troupeaux (chiens de protection, parcs électrifiés, gardiennage renforcé, etc.). En revanche, les exploitations situées en cercle 2, souvent qualifiées de front de colonisation, pouvaient être indemnisées sans obligation préalable de protection, en raison du caractère émergent ou incertain du risque. Le nouveau décret met fin à cette distinction. Désormais, dans les zones classées en cercle 2, le versement des indemnisations sera conditionné à la mise en œuvre effective de moyens de protection au-delà de la deuxième attaque reconnue au cours de l’année. Autrement dit, les deux premières attaques restent indemnisables sans exigence de protection préalable, mais toute attaque ultérieure ne donnera lieu à indemnisation que si l’éleveur a engagé des mesures de prévention adaptées. Cette évolution marque un tournant dans la politique de gestion du risque de prédation. Elle vise à encourager l’anticipation et la généralisation progressive des dispositifs de protection dans les territoires en phase de colonisation, tout en tenant compte des difficultés techniques et économiques rencontrées par les éleveurs lors des premières attaques. Le décret apporte également une clarification terminologique importante. Jusqu’ici, certaines décisions d’indemnisation faisaient principalement référence à la mortalité des animaux. Le nouveau texte élargit explicitement le champ des indemnisations à l’ensemble des dommages subis par les troupeaux, incluant désormais les blessures, en cohérence avec la réalité des impacts économiques et sanitaires pour les exploitations. Cette réforme s’inscrit dans un contexte de progression géographique du loup et de tensions croissantes entre objectifs de conservation de l’espèce et viabilité des systèmes d’élevage extensifs. Elle renforce la logique de responsabilité partagée entre l’État et les éleveurs, en faisant de la prévention un préalable de plus en plus central à l’accès à l’indemnisation publique.
Quelques brèves de chez nous et... d'ailleurs


 Depuis 2021, la HPAI est devenue une épizootie mondiale, affectant plusieurs continents et un nombre inédit d’espèces d’oiseaux et de mammifères, soulevant des préoccupations croissantes en matière de conservation et d’approche One Health. Les données récentes illustrent l’ampleur et la persistance du phénomène. En Europe, une activité exceptionnellement élevée a été observée lors de la migration automnale 2025, avec un nombre de détections chez les oiseaux sauvages multiplié par quatre par rapport à 2024, atteignant des niveaux inégalés depuis 2016. Dans les régions subantarctiques, des infections ont été signalées chez les éléphants de mer du sud, aggravant des déclins démographiques déjà sévères. Par ailleurs, dans les îles Malouines, des épidémies récurrentes ont entraîné une diminution notable des effectifs nicheurs d’albatros à sourcils noirs en 2024 et 2025. Ces événements de mortalité massive ont des conséquences écologiques profondes, notamment des déclins de population, des échecs reproductifs et des perturbations des interactions interspécifiques, susceptibles d’affecter durablement la stabilité des écosystèmes. Le débordement viral vers les mammifères renforce également les enjeux sanitaires à l’interface entre faune sauvage, animaux domestiques et santé humaine. La limitation des impacts de la HPAI repose sur une surveillance renforcée et coordonnée de la faune, une caractérisation génomique rapide des virus, un partage accru des données et l’intégration d’actions de conservation ciblées.
Depuis 2021, la HPAI est devenue une épizootie mondiale, affectant plusieurs continents et un nombre inédit d’espèces d’oiseaux et de mammifères, soulevant des préoccupations croissantes en matière de conservation et d’approche One Health. Les données récentes illustrent l’ampleur et la persistance du phénomène. En Europe, une activité exceptionnellement élevée a été observée lors de la migration automnale 2025, avec un nombre de détections chez les oiseaux sauvages multiplié par quatre par rapport à 2024, atteignant des niveaux inégalés depuis 2016. Dans les régions subantarctiques, des infections ont été signalées chez les éléphants de mer du sud, aggravant des déclins démographiques déjà sévères. Par ailleurs, dans les îles Malouines, des épidémies récurrentes ont entraîné une diminution notable des effectifs nicheurs d’albatros à sourcils noirs en 2024 et 2025. Ces événements de mortalité massive ont des conséquences écologiques profondes, notamment des déclins de population, des échecs reproductifs et des perturbations des interactions interspécifiques, susceptibles d’affecter durablement la stabilité des écosystèmes. Le débordement viral vers les mammifères renforce également les enjeux sanitaires à l’interface entre faune sauvage, animaux domestiques et santé humaine. La limitation des impacts de la HPAI repose sur une surveillance renforcée et coordonnée de la faune, une caractérisation génomique rapide des virus, un partage accru des données et l’intégration d’actions de conservation ciblées. Les espèces exotiques envahissantes constituent la deuxième menace la plus répandue, affectant près de 30 % des sites, tandis que les maladies de la faune et de la flore connaissent une progression inquiétante. Le risque lié aux agents pathogènes est désormais jugé élevé ou très élevé dans 9 % des sites (contre 2 % il y a cinq ans). Des maladies comme la grippe aviaire, la chytridiomycose des amphibiens ou encore des pathologies touchant les mangroves et les primates fragilisent des écosystèmes entiers et menacent des espèces clés.
Les espèces exotiques envahissantes constituent la deuxième menace la plus répandue, affectant près de 30 % des sites, tandis que les maladies de la faune et de la flore connaissent une progression inquiétante. Le risque lié aux agents pathogènes est désormais jugé élevé ou très élevé dans 9 % des sites (contre 2 % il y a cinq ans). Des maladies comme la grippe aviaire, la chytridiomycose des amphibiens ou encore des pathologies touchant les mangroves et les primates fragilisent des écosystèmes entiers et menacent des espèces clés.  Le rapport, fondé sur dix années d’évaluations, montre une dégradation globale des perspectives de conservation. Les sites reconnus pour leur exceptionnelle biodiversité sont les plus durement touchés. Les auteurs soulignent le caractère interconnecté des menaces, le changement climatique favorisant la propagation des espèces invasives et des agents pathogènes, parfois amplifiée par un tourisme non durable. Face à ce constat, l’UICN insiste sur le rôle déterminant d’une gestion efficace et durable. Or, seulement la moitié des sites bénéficient actuellement d’un niveau de protection satisfaisant, et 15 % souffrent d’un manque critique de financements. À l’inverse, des progrès notables ont été observés sur treize sites entre 2020 et 2025, notamment en Afrique, grâce à des investissements ciblés, à la lutte contre le braconnage et à l’implication des communautés locales. Les experts soulignent le rôle des peuples autochtones, dont les savoirs et la gestion traditionnelle ont démontré leur efficacité pour améliorer la résilience des sites. (
Le rapport, fondé sur dix années d’évaluations, montre une dégradation globale des perspectives de conservation. Les sites reconnus pour leur exceptionnelle biodiversité sont les plus durement touchés. Les auteurs soulignent le caractère interconnecté des menaces, le changement climatique favorisant la propagation des espèces invasives et des agents pathogènes, parfois amplifiée par un tourisme non durable. Face à ce constat, l’UICN insiste sur le rôle déterminant d’une gestion efficace et durable. Or, seulement la moitié des sites bénéficient actuellement d’un niveau de protection satisfaisant, et 15 % souffrent d’un manque critique de financements. À l’inverse, des progrès notables ont été observés sur treize sites entre 2020 et 2025, notamment en Afrique, grâce à des investissements ciblés, à la lutte contre le braconnage et à l’implication des communautés locales. Les experts soulignent le rôle des peuples autochtones, dont les savoirs et la gestion traditionnelle ont démontré leur efficacité pour améliorer la résilience des sites. ( La perte et la dégradation des habitats de reproduction constituent un facteur majeur. Le courlis cendré niche préférentiellement dans les prairies humides, landes ouvertes et zones alluviales, milieux largement affectés par le drainage, la conversion agricole et la fragmentation paysagère. La réduction de ces habitats entraîne une diminution des sites favorables à la nidification et une concentration accrue des couples sur des espaces résiduels, augmentant la vulnérabilité des nids. L’intensification des pratiques agricoles joue également un rôle central. Les dates de fauche précoces, l’usage de matériel agricole lourd et l’homogénéisation des prairies conduisent à la destruction directe des nids ou à l’exposition des œufs et des poussins. Par ailleurs, la modification de la structure végétale et des sols peut altérer la disponibilité des ressources trophiques indispensables à l’élevage des jeunes. La prédation constitue un autre facteur déterminant de l’échec reproducteur. Espèce nichant au sol, le courlis cendré est particulièrement exposé à des prédateurs généralistes (renards, corvidés), dont les populations peuvent être favorisées par les paysages anthropisés. Dans certaines régions, la majorité des nids suivis sont détruits avant l’éclosion. À ces pressions s’ajoutent le dérangement humain (activités de loisirs, circulation) et les effets du changement climatique, susceptibles de désynchroniser la période de reproduction avec les conditions hydriques et alimentaires optimales. Des épisodes climatiques extrêmes peuvent également affecter directement la viabilité des œufs. Enfin, l’analyse en cours de coquilles et d’œufs non éclos vise à explorer d’éventuels facteurs physiologiques ou toxicologiques, tels que des déficiences nutritionnelles ou une contamination environnementale, susceptibles d’altérer le développement embryonnaire. La convergence de ces facteurs explique en grande partie l’effondrement du succès reproducteur observé. Elle souligne l’urgence de mesures intégrées de conservation, associant restauration des habitats, adaptation des pratiques agricoles, limitation du dérangement et poursuite des recherches scientifiques ciblées.
La perte et la dégradation des habitats de reproduction constituent un facteur majeur. Le courlis cendré niche préférentiellement dans les prairies humides, landes ouvertes et zones alluviales, milieux largement affectés par le drainage, la conversion agricole et la fragmentation paysagère. La réduction de ces habitats entraîne une diminution des sites favorables à la nidification et une concentration accrue des couples sur des espaces résiduels, augmentant la vulnérabilité des nids. L’intensification des pratiques agricoles joue également un rôle central. Les dates de fauche précoces, l’usage de matériel agricole lourd et l’homogénéisation des prairies conduisent à la destruction directe des nids ou à l’exposition des œufs et des poussins. Par ailleurs, la modification de la structure végétale et des sols peut altérer la disponibilité des ressources trophiques indispensables à l’élevage des jeunes. La prédation constitue un autre facteur déterminant de l’échec reproducteur. Espèce nichant au sol, le courlis cendré est particulièrement exposé à des prédateurs généralistes (renards, corvidés), dont les populations peuvent être favorisées par les paysages anthropisés. Dans certaines régions, la majorité des nids suivis sont détruits avant l’éclosion. À ces pressions s’ajoutent le dérangement humain (activités de loisirs, circulation) et les effets du changement climatique, susceptibles de désynchroniser la période de reproduction avec les conditions hydriques et alimentaires optimales. Des épisodes climatiques extrêmes peuvent également affecter directement la viabilité des œufs. Enfin, l’analyse en cours de coquilles et d’œufs non éclos vise à explorer d’éventuels facteurs physiologiques ou toxicologiques, tels que des déficiences nutritionnelles ou une contamination environnementale, susceptibles d’altérer le développement embryonnaire. La convergence de ces facteurs explique en grande partie l’effondrement du succès reproducteur observé. Elle souligne l’urgence de mesures intégrées de conservation, associant restauration des habitats, adaptation des pratiques agricoles, limitation du dérangement et poursuite des recherches scientifiques ciblées. Leur lente dégradation explique leur accumulation dans les sols, l’eau et les organismes vivants, avec des conséquences sanitaires et environnementales majeures. L’étude évalue les coûts liés à l’impact des Pfas sur la santé humaine ainsi qu’aux opérations de dépollution des sols et des ressources en eau. Quatre scénarios ont été modélisés selon le niveau d’action de l’Union européenne. Le coût total varierait ainsi de 330 milliards à 1 700 milliards d’€ d’ici à 2050. Le scénario le plus onéreux inclut une dépollution massive des sols et le traitement des eaux usées afin de respecter des normes environnementales strictes pour une vingtaine de Pfas. À l’inverse, l’estimation la plus basse correspond à une interdiction totale de leur production et de leur utilisation, sans traitement supplémentaire de l’eau potable ni des eaux usées. Le rapport alerte également sur les conséquences sanitaires : près d’un Européen sur six, soit environ 76,5 millions de personnes, pourrait être contaminé et développer une maladie liée à l’exposition aux Pfas en l’absence de mesures correctives. Ces substances sont notamment associées à une augmentation du cholestérol, à des risques accrus de cancers, ainsi qu’à des effets sur la fertilité et le développement des fœtus. Face à ces enjeux, la Commission européenne envisage d’interdire les Pfas dans les produits de consommation courante, tout en prévoyant des dérogations pour certains secteurs stratégiques. Toutefois, une proposition législative ne devrait pas voir le jour avant fin 2026, Bruxelles attendant deux avis clés de l’Agence européenne des produits chimiques sur les risques sanitaires et l’impact socio-économique d’une interdiction.
Leur lente dégradation explique leur accumulation dans les sols, l’eau et les organismes vivants, avec des conséquences sanitaires et environnementales majeures. L’étude évalue les coûts liés à l’impact des Pfas sur la santé humaine ainsi qu’aux opérations de dépollution des sols et des ressources en eau. Quatre scénarios ont été modélisés selon le niveau d’action de l’Union européenne. Le coût total varierait ainsi de 330 milliards à 1 700 milliards d’€ d’ici à 2050. Le scénario le plus onéreux inclut une dépollution massive des sols et le traitement des eaux usées afin de respecter des normes environnementales strictes pour une vingtaine de Pfas. À l’inverse, l’estimation la plus basse correspond à une interdiction totale de leur production et de leur utilisation, sans traitement supplémentaire de l’eau potable ni des eaux usées. Le rapport alerte également sur les conséquences sanitaires : près d’un Européen sur six, soit environ 76,5 millions de personnes, pourrait être contaminé et développer une maladie liée à l’exposition aux Pfas en l’absence de mesures correctives. Ces substances sont notamment associées à une augmentation du cholestérol, à des risques accrus de cancers, ainsi qu’à des effets sur la fertilité et le développement des fœtus. Face à ces enjeux, la Commission européenne envisage d’interdire les Pfas dans les produits de consommation courante, tout en prévoyant des dérogations pour certains secteurs stratégiques. Toutefois, une proposition législative ne devrait pas voir le jour avant fin 2026, Bruxelles attendant deux avis clés de l’Agence européenne des produits chimiques sur les risques sanitaires et l’impact socio-économique d’une interdiction. Au cœur du projet se trouve un mécanisme encore peu intégré aux modèles actuels : la thigmomorphogénèse, c’est-à-dire la capacité des arbres à modifier activement leur croissance en réponse aux sollicitations mécaniques. Contrairement à l’idée d’une croissance purement passive, les arbres perçoivent les oscillations induites par le vent et y répondent en adaptant leur architecture. « La croissance doit être envisagée comme un processus d’acclimatation », souligne Jana Dlouhá, responsable scientifique du projet. Sous l’effet répété des rafales, les cellules du tronc, des branches et des racines subissent de micro-déformations comparables à celles de muscles en mouvement. Ces signaux mécaniques déclenchent des ajustements : renforcement de la base et des racines, limitation de la croissance en hauteur, modification des propriétés du bois. L’arbre cherche ainsi un compromis entre l’accès à la lumière et la sécurité mécanique. Cet enjeu est crucial pour la gestion forestière. Le vent représente déjà plus de 40 % des pertes de biomasse forestière en Europe, et ce chiffre pourrait augmenter avec le changement climatique. Pourtant, la vulnérabilité mécanique des peuplements est encore évaluée à l’aide de modèles empiriques, notamment après des interventions sylvicoles comme les éclaircies. Or les ouvertures de canopée, liées aux coupes ou aux mortalités d’arbres, ont augmenté de 24 à 30 % depuis le début du 21e siècle, exposant temporairement les arbres restants à un risque accru. Wind-Sweep vise précisément à mieux comprendre et anticiper cette phase critique. En montrant que le vent n’est pas seulement un aléa destructeur mais aussi un architecte de la forme et de la résistance des arbres, Wind-Sweep ouvre la voie à une gestion forestière plus fine, capable d’intégrer les forces naturelles plutôt que de les subir.
Au cœur du projet se trouve un mécanisme encore peu intégré aux modèles actuels : la thigmomorphogénèse, c’est-à-dire la capacité des arbres à modifier activement leur croissance en réponse aux sollicitations mécaniques. Contrairement à l’idée d’une croissance purement passive, les arbres perçoivent les oscillations induites par le vent et y répondent en adaptant leur architecture. « La croissance doit être envisagée comme un processus d’acclimatation », souligne Jana Dlouhá, responsable scientifique du projet. Sous l’effet répété des rafales, les cellules du tronc, des branches et des racines subissent de micro-déformations comparables à celles de muscles en mouvement. Ces signaux mécaniques déclenchent des ajustements : renforcement de la base et des racines, limitation de la croissance en hauteur, modification des propriétés du bois. L’arbre cherche ainsi un compromis entre l’accès à la lumière et la sécurité mécanique. Cet enjeu est crucial pour la gestion forestière. Le vent représente déjà plus de 40 % des pertes de biomasse forestière en Europe, et ce chiffre pourrait augmenter avec le changement climatique. Pourtant, la vulnérabilité mécanique des peuplements est encore évaluée à l’aide de modèles empiriques, notamment après des interventions sylvicoles comme les éclaircies. Or les ouvertures de canopée, liées aux coupes ou aux mortalités d’arbres, ont augmenté de 24 à 30 % depuis le début du 21e siècle, exposant temporairement les arbres restants à un risque accru. Wind-Sweep vise précisément à mieux comprendre et anticiper cette phase critique. En montrant que le vent n’est pas seulement un aléa destructeur mais aussi un architecte de la forme et de la résistance des arbres, Wind-Sweep ouvre la voie à une gestion forestière plus fine, capable d’intégrer les forces naturelles plutôt que de les subir. l’Ardèche, le Tarn, les Pyrénées-Orientales, la Vienne, la Meuse, la Corrèze, le Puy-de-Dôme, l’Aude, l’Ain, la Haute-Loire, la Creuse, le Cantal, la Haute-Garonne, l’Allier, la Haute-Marne, le Vaucluse, la Haute-Saône, l’Yonne, la Haute-Vienne, la Seine-Maritime, le Loiret, le Bas-Rhin, et même le Finistère parmi d’autres. Aux attaques répétées sur les ovins du Puy-de-Dôme, qui ont fait plusieurs victimes en janvier 2026, s’ajoutent des constats quasiment quotidiens d’éleveurs dépassés par la prédation. La Dreal et les associations agricoles pointent une progression sur tout l’arc méridional et vers le nord-ouest, jusqu’à des signalements dans les départements de Mayenne, Manche et Orne, ce qui n’était pas le cas. Face à cette situation, l’État déploie un arsenal réglementaire complexe, des plans d’actions successifs, des systèmes d’indemnisation, des « tirs de défense », des réseaux de suivi et des expertises scientifiques, mais le coût pour les contribuables explose, tandis que de nombreux éleveurs restent sans réelle protection effective. Le débat s’enlise entre écologie strictement protectionniste et nécessité de sauvegarder des filières d’élevage, souvent héritées de siècles de pastoralisme. Quand donc s’arrêtera cette mascarade ?
l’Ardèche, le Tarn, les Pyrénées-Orientales, la Vienne, la Meuse, la Corrèze, le Puy-de-Dôme, l’Aude, l’Ain, la Haute-Loire, la Creuse, le Cantal, la Haute-Garonne, l’Allier, la Haute-Marne, le Vaucluse, la Haute-Saône, l’Yonne, la Haute-Vienne, la Seine-Maritime, le Loiret, le Bas-Rhin, et même le Finistère parmi d’autres. Aux attaques répétées sur les ovins du Puy-de-Dôme, qui ont fait plusieurs victimes en janvier 2026, s’ajoutent des constats quasiment quotidiens d’éleveurs dépassés par la prédation. La Dreal et les associations agricoles pointent une progression sur tout l’arc méridional et vers le nord-ouest, jusqu’à des signalements dans les départements de Mayenne, Manche et Orne, ce qui n’était pas le cas. Face à cette situation, l’État déploie un arsenal réglementaire complexe, des plans d’actions successifs, des systèmes d’indemnisation, des « tirs de défense », des réseaux de suivi et des expertises scientifiques, mais le coût pour les contribuables explose, tandis que de nombreux éleveurs restent sans réelle protection effective. Le débat s’enlise entre écologie strictement protectionniste et nécessité de sauvegarder des filières d’élevage, souvent héritées de siècles de pastoralisme. Quand donc s’arrêtera cette mascarade ?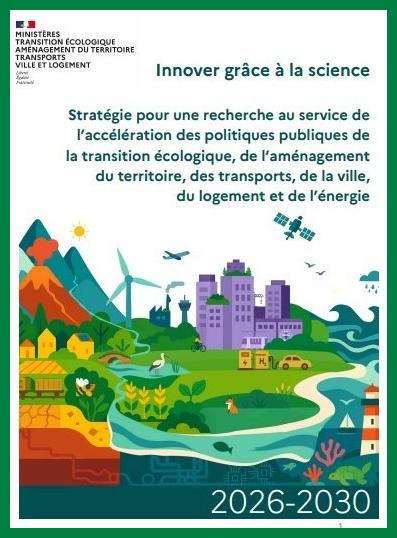 C’est dans cette perspective que plusieurs ministères en charge de la transition écologique, de la biodiversité, de l’aménagement du territoire, des transports, de la ville et du logement, ont élaboré une stratégie de recherche commune. Construite en lien étroit avec leurs services et les organismes scientifiques partenaires, cette démarche vise à mieux articuler les besoins des politiques publiques avec les capacités de la recherche publique, afin de répondre concrètement aux attentes des citoyens. La stratégie définie permet d’identifier les priorités de connaissance nécessaires pour concevoir, ajuster et évaluer les politiques publiques. Elle s’organise autour de trois grands enjeux scientifiques majeurs. Le premier concerne la mise en œuvre d’une transition écologique juste, attentive aux inégalités sociales et territoriales, afin qu’aucune population ni aucun territoire ne soit laissé de côté. Le deuxième enjeu vise la construction d’un avenir vivable et respectueux du vivant, en préservant la biodiversité, les ressources naturelles et les équilibres écologiques. Enfin, le troisième enjeu porte sur le renforcement de la résilience des territoires et des acteurs face aux crises climatiques, environnementales et sociales, appelées à se multiplier dans les années à venir. L’ambition de cette stratégie est claire : rapprocher durablement la recherche scientifique des décideurs publics, pour appuyer la transition écologique tout en contribuant au développement économique et à la cohésion des territoires. Au cœur de ce dispositif, le réseau scientifique et technique, animé par le Commissariat général au développement durable, rassemble près de quarante organismes aux compétences complémentaires en matière de recherche, de données, d’ingénierie et d’expertise.
C’est dans cette perspective que plusieurs ministères en charge de la transition écologique, de la biodiversité, de l’aménagement du territoire, des transports, de la ville et du logement, ont élaboré une stratégie de recherche commune. Construite en lien étroit avec leurs services et les organismes scientifiques partenaires, cette démarche vise à mieux articuler les besoins des politiques publiques avec les capacités de la recherche publique, afin de répondre concrètement aux attentes des citoyens. La stratégie définie permet d’identifier les priorités de connaissance nécessaires pour concevoir, ajuster et évaluer les politiques publiques. Elle s’organise autour de trois grands enjeux scientifiques majeurs. Le premier concerne la mise en œuvre d’une transition écologique juste, attentive aux inégalités sociales et territoriales, afin qu’aucune population ni aucun territoire ne soit laissé de côté. Le deuxième enjeu vise la construction d’un avenir vivable et respectueux du vivant, en préservant la biodiversité, les ressources naturelles et les équilibres écologiques. Enfin, le troisième enjeu porte sur le renforcement de la résilience des territoires et des acteurs face aux crises climatiques, environnementales et sociales, appelées à se multiplier dans les années à venir. L’ambition de cette stratégie est claire : rapprocher durablement la recherche scientifique des décideurs publics, pour appuyer la transition écologique tout en contribuant au développement économique et à la cohésion des territoires. Au cœur de ce dispositif, le réseau scientifique et technique, animé par le Commissariat général au développement durable, rassemble près de quarante organismes aux compétences complémentaires en matière de recherche, de données, d’ingénierie et d’expertise.  Le bouquetin est une espèce protégée, malheureusement non chassable en France. Aucun chasseur, aucune FDC n’a donc demandé, organisé ces abattages administratifs. Assimiler cette opération à un acte de chasse relève soit de l’ignorance, soit de la mauvaise foi. On parle ici d’une décision sanitaire de l’État, prise par arrêté, exécutée par ses services. Point final. Deuxième quiproquo, soigneusement entretenu par certaines organisations écologistes : faire croire que ces abattages seraient une concession au « lobby de la chasse » ou à une pulsion destructrice d’un État autoritaire. En réalité, le cœur du problème est ailleurs. Depuis le début, la gestion de la brucellose dans le Bargy est pensée presque exclusivement à travers le prisme de l’élevage et de la filière fromagère locale. Et pas n’importe laquelle : celle des producteurs de Reblochon, et le bouquetin, animal sauvage protégé, sert ici de variable d’ajustement. C’est là que le discours des écolos devient franchement indécent. En prétendant défendre la biodiversité, ils piétinent allègrement l’élevage de montagne, pourtant déjà sous pression. Leur combat n’est ni social ni scientifique : il est idéologique. Ce qui compte, c’est de gagner en justice, de faire tomber le préfet et d’alimenter le récit d’un État destructeur. Ironie finale : à force de postures, on obtient exactement l’inverse de ce qui est affiché. La brucellose circule toujours et l’élevage reste sous tension... Un quiproquo, certes, mais un quiproquo mortel !
Le bouquetin est une espèce protégée, malheureusement non chassable en France. Aucun chasseur, aucune FDC n’a donc demandé, organisé ces abattages administratifs. Assimiler cette opération à un acte de chasse relève soit de l’ignorance, soit de la mauvaise foi. On parle ici d’une décision sanitaire de l’État, prise par arrêté, exécutée par ses services. Point final. Deuxième quiproquo, soigneusement entretenu par certaines organisations écologistes : faire croire que ces abattages seraient une concession au « lobby de la chasse » ou à une pulsion destructrice d’un État autoritaire. En réalité, le cœur du problème est ailleurs. Depuis le début, la gestion de la brucellose dans le Bargy est pensée presque exclusivement à travers le prisme de l’élevage et de la filière fromagère locale. Et pas n’importe laquelle : celle des producteurs de Reblochon, et le bouquetin, animal sauvage protégé, sert ici de variable d’ajustement. C’est là que le discours des écolos devient franchement indécent. En prétendant défendre la biodiversité, ils piétinent allègrement l’élevage de montagne, pourtant déjà sous pression. Leur combat n’est ni social ni scientifique : il est idéologique. Ce qui compte, c’est de gagner en justice, de faire tomber le préfet et d’alimenter le récit d’un État destructeur. Ironie finale : à force de postures, on obtient exactement l’inverse de ce qui est affiché. La brucellose circule toujours et l’élevage reste sous tension... Un quiproquo, certes, mais un quiproquo mortel ! Selon les éléments actuellement disponibles, les données susceptibles d’avoir été concernées incluent notamment : le nom, le nom de naissance, les prénoms, la date et la ville de naissance, l’adresse postale, les numéros de téléphone fixe et portable, la nationalité, l’adresse électronique, le numéro de permis de chasser, ainsi que des informations liées aux démarches administratives et à l’examen du permis (convocations, dates, présence, résultats, inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes). L’OFB précise qu’aucune donnée bancaire, de santé ou relative à la détention d’armes n’a été compromise dans le cadre de cet incident. Dès la découverte de la cyberattaque, plusieurs mesures ont été mises en œuvre :
Selon les éléments actuellement disponibles, les données susceptibles d’avoir été concernées incluent notamment : le nom, le nom de naissance, les prénoms, la date et la ville de naissance, l’adresse postale, les numéros de téléphone fixe et portable, la nationalité, l’adresse électronique, le numéro de permis de chasser, ainsi que des informations liées aux démarches administratives et à l’examen du permis (convocations, dates, présence, résultats, inscription au fichier national des personnes interdites d’acquisition et de détention d’armes). L’OFB précise qu’aucune donnée bancaire, de santé ou relative à la détention d’armes n’a été compromise dans le cadre de cet incident. Dès la découverte de la cyberattaque, plusieurs mesures ont été mises en œuvre : Après avoir été médicalisé sur place, le chasseur a été hélitreuillé, puis évacué par les airs vers un centre hospitalier lyonnais. Au total, une quinzaine de secouristes ont été mobilisés pour cette opération d’envergure. Une enquête devra permettre de déterminer les circonstances exactes de l’accident.
Après avoir été médicalisé sur place, le chasseur a été hélitreuillé, puis évacué par les airs vers un centre hospitalier lyonnais. Au total, une quinzaine de secouristes ont été mobilisés pour cette opération d’envergure. Une enquête devra permettre de déterminer les circonstances exactes de l’accident. À quatre reprises, un prédateur s’en est pris au troupeau, provoquant la mort d’environ quarante brebis. Les premières constatations effectuées sur place laissent envisager la piste du loup, sans que cette hypothèse ne soit, à ce stade, formellement confirmée. Les investigations se poursuivent sous l’autorité des services de l’État. Face à l’ampleur des pertes, la famille d’éleveurs est sous le choc et le patron exprime une vive colère. Il dénonce ce qu’il qualifie de « silence et d’hypocrisie » de la Sous-préfecture de Limoux, estimant manquer d’informations claires et de réponses concrètes. Alors que l’attente des conclusions officielles se prolonge, cette série d’attaques ravive les inquiétudes du monde agricole local et relance le débat sur la protection des troupeaux et l’accompagnement des éleveurs confrontés à la prédation.
À quatre reprises, un prédateur s’en est pris au troupeau, provoquant la mort d’environ quarante brebis. Les premières constatations effectuées sur place laissent envisager la piste du loup, sans que cette hypothèse ne soit, à ce stade, formellement confirmée. Les investigations se poursuivent sous l’autorité des services de l’État. Face à l’ampleur des pertes, la famille d’éleveurs est sous le choc et le patron exprime une vive colère. Il dénonce ce qu’il qualifie de « silence et d’hypocrisie » de la Sous-préfecture de Limoux, estimant manquer d’informations claires et de réponses concrètes. Alors que l’attente des conclusions officielles se prolonge, cette série d’attaques ravive les inquiétudes du monde agricole local et relance le débat sur la protection des troupeaux et l’accompagnement des éleveurs confrontés à la prédation. Leur déclin, observé de manière continue depuis les années 1960, est aujourd’hui largement documenté par les suivis cynégétiques, les programmes STOC et les travaux de l’ex ONCFS, puis de l’OFB. Contrairement à une idée encore répandue, ce recul n’est pas principalement imputable à la pression de chasse, mais à une combinaison de facteurs structurels :
Leur déclin, observé de manière continue depuis les années 1960, est aujourd’hui largement documenté par les suivis cynégétiques, les programmes STOC et les travaux de l’ex ONCFS, puis de l’OFB. Contrairement à une idée encore répandue, ce recul n’est pas principalement imputable à la pression de chasse, mais à une combinaison de facteurs structurels :  simplification des paysages agricoles, disparition des infrastructures écologiques (haies, bandes enherbées, jachères), augmentation de la mortalité juvénile liée aux pratiques culturales, protection de certains prédateurs et dérèglement climatique affectant la reproduction. La dynamique de ces espèces repose sur un équilibre fin entre reproduction, survie et qualité de l’habitat. Les études montrent que, sans restauration fonctionnelle des milieux, aucune politique de restriction des prélèvements ne permet un redressement durable des populations. À l’inverse, les territoires ayant engagé des programmes intégrés (aménagements paysagers, régulation raisonnée des prédateurs opportunistes, limitation volontaire du tir) observent des recolonisations progressives mais mesurables. Ces résultats confirment que le petit gibier sédentaire ne peut être géré comme une simple ressource cynégétique, mais comme un compartiment à part entière de la biodiversité ordinaire...
simplification des paysages agricoles, disparition des infrastructures écologiques (haies, bandes enherbées, jachères), augmentation de la mortalité juvénile liée aux pratiques culturales, protection de certains prédateurs et dérèglement climatique affectant la reproduction. La dynamique de ces espèces repose sur un équilibre fin entre reproduction, survie et qualité de l’habitat. Les études montrent que, sans restauration fonctionnelle des milieux, aucune politique de restriction des prélèvements ne permet un redressement durable des populations. À l’inverse, les territoires ayant engagé des programmes intégrés (aménagements paysagers, régulation raisonnée des prédateurs opportunistes, limitation volontaire du tir) observent des recolonisations progressives mais mesurables. Ces résultats confirment que le petit gibier sédentaire ne peut être géré comme une simple ressource cynégétique, mais comme un compartiment à part entière de la biodiversité ordinaire...