 Les Vosges et l’Afrique sont deux territoires que Pierre Moinot a exploré le fusil à la main. Il a descendu les grands fleuves d’Afrique pour y chasser l’hippopotame, avec François Bel, dédicataire de « La mort en lui », puis tourne le fameux documentaire « La griffe et la dent », dont il assure la préface et les textes, pour l’édition en livres. Avec le haut fonctionnaire, cohabite donc un réel écrivain. Jeune, Pierre Moinot est fasciné par Giono. Il lui doit son prix au Concours général, pour avoir traité, avec maestria, le sujet « Comment les hommes font parler les bêtes et l’inverse », car, oublieux des fabulistes, il s’inspire de Giono. Il est adoubé par Camus et Sartre qui soutiennent la publication de « Armes et bagages », et il se lie d’amitié avec Louis Guilloux et Jules Roy. On peut le classer dans les romanciers moralistes qui scrutent l’âme humaine en action, d’où son étude sur Lawrence d’Arabie, dans laquelle il note, désabusé : « l’homme est une guerre civile ». De nombreux prix récompensent ses films (La griffe et la dent) et pièces de théâtre (Héliogabale), ainsi que ses romans et nouvelles. Il est donc logiquement élu au 19e fauteuil de l’Académie Française, sur lequel siégèrent avant lui, Chateaubriand, Deschanel, René Clair.
Les Vosges et l’Afrique sont deux territoires que Pierre Moinot a exploré le fusil à la main. Il a descendu les grands fleuves d’Afrique pour y chasser l’hippopotame, avec François Bel, dédicataire de « La mort en lui », puis tourne le fameux documentaire « La griffe et la dent », dont il assure la préface et les textes, pour l’édition en livres. Avec le haut fonctionnaire, cohabite donc un réel écrivain. Jeune, Pierre Moinot est fasciné par Giono. Il lui doit son prix au Concours général, pour avoir traité, avec maestria, le sujet « Comment les hommes font parler les bêtes et l’inverse », car, oublieux des fabulistes, il s’inspire de Giono. Il est adoubé par Camus et Sartre qui soutiennent la publication de « Armes et bagages », et il se lie d’amitié avec Louis Guilloux et Jules Roy. On peut le classer dans les romanciers moralistes qui scrutent l’âme humaine en action, d’où son étude sur Lawrence d’Arabie, dans laquelle il note, désabusé : « l’homme est une guerre civile ». De nombreux prix récompensent ses films (La griffe et la dent) et pièces de théâtre (Héliogabale), ainsi que ses romans et nouvelles. Il est donc logiquement élu au 19e fauteuil de l’Académie Française, sur lequel siégèrent avant lui, Chateaubriand, Deschanel, René Clair.
Ses ouvrages
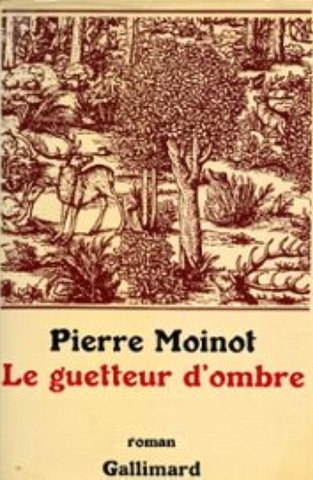 Publiée en 1953, « La chasse royale », avec ses 9 éditions, trouve un large public, de même que « Le guetteur d’ombre », une œuvre magistrale. Puis, suit l’introduction de 16 pages dans « Anthologie du cerf », et le texte de présentation du livre, support du film « La griffe et la dent », en 1977. Il n’y a pas d’anthropomorphisme, mais la mise en évidence que chaque espèce se spécialise pour survivre, et demande un élan continu et permanent pour se réaliser. « La mort en lui » est un opuscule de 4 nouvelles, dont « Retour de chasse », où le héros est la copie du chasseur guetteur d’ombre, mais ici, avec le patronyme de Lortier. Cet ouvrage est justement récompensé, en 2002, du Prix François Sommer/Maison de la Chasse. La même année, il publie, avec deux autres écrivains cynégétiques, Xavier Patier et Philippe Verro, « Chasses à cœur ouvert ». Pierre Moinot consacre peu de pages au chien. Tout juste apparaissent quelques sujets : un teckel anonyme, Comtesse et le brave et bon César. Dans « La chasse royale », le garde replace les intestins du pauvre chien éventré, après les avoir enduits de beurre pour qu’ils retrouvent plus facilement leur place. Ainsi, par la connaissance de ses terrains de chasse, le garde supplée au chien. Il peut reconstituer le passage de chaque animal : « Voyons ça… Le premier soir, il passait la crête, là-dessus, sur la source. Le second jour, vous voyez le pied du jeune page… Vous le prenez pour une vielle biche et puis vous voyez la harde de loin par corps… ». Le tir permet à Pierre Moinot de s’intéresser aux armes : « Je m’assis sur une souche, ma carabine sur les genoux. Je caressais sa fine gravure, puis le canon luisant. La balle se logeait dans une partie que l’on nommait l’âme, et la mort se glissait dans cette âme comme elle habitait la mienne depuis toujours… ». Mais le tir est la conclusion d’un « vide glacé, une respiration suspendue, un déclenchement de mécanique. On ne tirait pas un grand gibier comme une cible au stand, ou une bouteille dans une carrière… ». Lortier est poursuivi par l’image d’une biche qu’il avait blessée à mort, sans avoir pu retrouver la dépouille. Aussi, il accepte l’avis de son ami Henri, qui le console ainsi : « On ne peut pas risquer une balle dans ces conditions. Une bête comme celle-là ne se blesse pas ! ». Le tir est l’instant de vérité. Lortier et son arme n’étaient qu’une masse froide et dure, lentement aimantée par l’animal, et que la balle allait souder à lui. Le chasseur Moinot se sent relié au chasseur du paléolithique ou à celui des savanes africaines. « La courbure gracile de la crosse, les fines grenures sculptées, la joue de noyer aux nœuds patinés, l’effilement du canon surmonté des angles nets et du cheminement de la ligne de mire, avaient pour usage de tuer… Ceux qui aiment les armes oublient souvent à quoi elles servent… ». Il se souvient brusquement, avec une sorte de vertige, qu’une des premières figurations connues pour avoir été tracée, il y a une bonne dizaine de milliers d’années par la main d’un homme, est la gravure d’un bouquetin sur un propulseur de javelot ». Moinot, comme Malraux, porte en lui son musée imaginaire. Le chasseur rejoint le poste, un pommier sauvage où « les chasseurs successifs avaient pris le soin de ranger l’une à côté de l’autre, ces douilles vides qui les faisaient ressembler à de bizarres ex-voto… ».
Publiée en 1953, « La chasse royale », avec ses 9 éditions, trouve un large public, de même que « Le guetteur d’ombre », une œuvre magistrale. Puis, suit l’introduction de 16 pages dans « Anthologie du cerf », et le texte de présentation du livre, support du film « La griffe et la dent », en 1977. Il n’y a pas d’anthropomorphisme, mais la mise en évidence que chaque espèce se spécialise pour survivre, et demande un élan continu et permanent pour se réaliser. « La mort en lui » est un opuscule de 4 nouvelles, dont « Retour de chasse », où le héros est la copie du chasseur guetteur d’ombre, mais ici, avec le patronyme de Lortier. Cet ouvrage est justement récompensé, en 2002, du Prix François Sommer/Maison de la Chasse. La même année, il publie, avec deux autres écrivains cynégétiques, Xavier Patier et Philippe Verro, « Chasses à cœur ouvert ». Pierre Moinot consacre peu de pages au chien. Tout juste apparaissent quelques sujets : un teckel anonyme, Comtesse et le brave et bon César. Dans « La chasse royale », le garde replace les intestins du pauvre chien éventré, après les avoir enduits de beurre pour qu’ils retrouvent plus facilement leur place. Ainsi, par la connaissance de ses terrains de chasse, le garde supplée au chien. Il peut reconstituer le passage de chaque animal : « Voyons ça… Le premier soir, il passait la crête, là-dessus, sur la source. Le second jour, vous voyez le pied du jeune page… Vous le prenez pour une vielle biche et puis vous voyez la harde de loin par corps… ». Le tir permet à Pierre Moinot de s’intéresser aux armes : « Je m’assis sur une souche, ma carabine sur les genoux. Je caressais sa fine gravure, puis le canon luisant. La balle se logeait dans une partie que l’on nommait l’âme, et la mort se glissait dans cette âme comme elle habitait la mienne depuis toujours… ». Mais le tir est la conclusion d’un « vide glacé, une respiration suspendue, un déclenchement de mécanique. On ne tirait pas un grand gibier comme une cible au stand, ou une bouteille dans une carrière… ». Lortier est poursuivi par l’image d’une biche qu’il avait blessée à mort, sans avoir pu retrouver la dépouille. Aussi, il accepte l’avis de son ami Henri, qui le console ainsi : « On ne peut pas risquer une balle dans ces conditions. Une bête comme celle-là ne se blesse pas ! ». Le tir est l’instant de vérité. Lortier et son arme n’étaient qu’une masse froide et dure, lentement aimantée par l’animal, et que la balle allait souder à lui. Le chasseur Moinot se sent relié au chasseur du paléolithique ou à celui des savanes africaines. « La courbure gracile de la crosse, les fines grenures sculptées, la joue de noyer aux nœuds patinés, l’effilement du canon surmonté des angles nets et du cheminement de la ligne de mire, avaient pour usage de tuer… Ceux qui aiment les armes oublient souvent à quoi elles servent… ». Il se souvient brusquement, avec une sorte de vertige, qu’une des premières figurations connues pour avoir été tracée, il y a une bonne dizaine de milliers d’années par la main d’un homme, est la gravure d’un bouquetin sur un propulseur de javelot ». Moinot, comme Malraux, porte en lui son musée imaginaire. Le chasseur rejoint le poste, un pommier sauvage où « les chasseurs successifs avaient pris le soin de ranger l’une à côté de l’autre, ces douilles vides qui les faisaient ressembler à de bizarres ex-voto… ».
Comme Malraux
Pierre Moinot aussi a ses voix du silence : « C’est la mer verte des Vosges, haute de ses futaies. La plainte répétée des charpentes de bateaux portées d’une pesée sur l’autre, par le balancier de la houle, mais profonde de son entrelacs de racines. J’ai souvent imaginé le paysage souterrain que dessine les énormes bouquets de racines, les veines des roches, les coulées des argiles, l’enchevêtrement de tout ce qui pousse et pénètre en-dessous des régions visibles… ». La chasse, c’est la mort acceptée du gibier : « Je sors mon couteau de sa gaine, je mets le chevreuil sur le dos en écartant les pattes arrière. L’œil est déjà opaque, d’un très beau vert émeraude. La langue pointe entre les mâchoires serrées. Voilà donc l’arrêt de cette mécanique. Je ne suis plus là ni dans la morale, ni dans l‘espérance, ni dans le repos et la paix, ni dans la consolation ou la récompense. Je suis dans l’ordre irréparable de la mort qui marche à côté de la vie, comme son reflet… ». Mais il faut aussi évoquer l’écrin de la chasse et des animaux, les forêts qui agrandissent l’homme, car il marche sur « la pourriture nourricière des feuilles mortes et se dissout dans ces ténèbres, dans la senteur sourde des sapins… ». Il ne faut pas y chercher une page d’écriture folklorique locale. Tout juste quelques noms à consonance germanique, qui piquettent le roman et entretiennent le souffle d’un dépaysement nécessaire. Le regard de Moinot glisse rapidement sur : « Le mur tapissé de massacres de chevreuils et de cerfs, montés à l’allemande sur des planchettes de noyer sombre, qui témoignaient d’un savoir-faire. Les bois bizarres, de forme anormale, dégénérée, parfois monstrueuse, indiquaient le soin, pendant des années, à éliminer du cheptel tous les animaux malades ou étranges… ».
Garde et protecteur du cheptel sauvage
 Pierre Moinot le confesse : « Peu à peu, c’est devenu différent. J’ai beaucoup approché les animaux… Il faut donc protéger la forêt des braconniers, ces pillards qui tuaient tout, sangliers, chèvres, chevreuils et petits, territoires qu’ils dévastaient jusqu’à ce qu’ils les aient rendus déserts. Ces hommes n‘étaient pas des chasseurs, mais des assassins… ». Il faut protéger cette beauté de l’animal sauvage, ce cerf « qui a une cépée sur la tête, des bois plus larges que lui, sous la gorge une fourrure épaisse. Une masse qui semble un bouclier de bronze, hérissé de pointes… ». Alors la loi du talion prime à coup de carabines chargées à chevrotines. C’est le triangle dangereux de « La chasse royale », entre les chasseurs, les gardes, la forêt, la maison d’Haudrenne et la bande de bracos. Moinot ressuscite l’histoire germanique de la balle magique. Dans un duel contre un cerf meurtrier, le chasseur n’a qu’une balle pour rompre le sort. Nous assistons, avec une crainte révérencieuse et presque dévote, aux grands orgues du brame, ces « clameurs funèbres, qui finissaient dans une sorte de râle ininterrompu, net comme l’arrêt d‘un archet, écrasé sur une corde… ». Tout au long de ces pages, tel un chaman, Moinot nous enveloppe dans ses mélopées littéraires où nous partageons les cycles de vies des animaux et des chasseurs. Chers compagnons de lecture, pour une fois, il ne vous sera pas possible de me taxer de sélectionner des auteurs poussiéreux et impossibles à dénicher. La réédition en livre de poche de « La chasse royale » porte le n° 2013… Plus d’excuses donc, pour ne pas se plonger dans ce grand texte.
Pierre Moinot le confesse : « Peu à peu, c’est devenu différent. J’ai beaucoup approché les animaux… Il faut donc protéger la forêt des braconniers, ces pillards qui tuaient tout, sangliers, chèvres, chevreuils et petits, territoires qu’ils dévastaient jusqu’à ce qu’ils les aient rendus déserts. Ces hommes n‘étaient pas des chasseurs, mais des assassins… ». Il faut protéger cette beauté de l’animal sauvage, ce cerf « qui a une cépée sur la tête, des bois plus larges que lui, sous la gorge une fourrure épaisse. Une masse qui semble un bouclier de bronze, hérissé de pointes… ». Alors la loi du talion prime à coup de carabines chargées à chevrotines. C’est le triangle dangereux de « La chasse royale », entre les chasseurs, les gardes, la forêt, la maison d’Haudrenne et la bande de bracos. Moinot ressuscite l’histoire germanique de la balle magique. Dans un duel contre un cerf meurtrier, le chasseur n’a qu’une balle pour rompre le sort. Nous assistons, avec une crainte révérencieuse et presque dévote, aux grands orgues du brame, ces « clameurs funèbres, qui finissaient dans une sorte de râle ininterrompu, net comme l’arrêt d‘un archet, écrasé sur une corde… ». Tout au long de ces pages, tel un chaman, Moinot nous enveloppe dans ses mélopées littéraires où nous partageons les cycles de vies des animaux et des chasseurs. Chers compagnons de lecture, pour une fois, il ne vous sera pas possible de me taxer de sélectionner des auteurs poussiéreux et impossibles à dénicher. La réédition en livre de poche de « La chasse royale » porte le n° 2013… Plus d’excuses donc, pour ne pas se plonger dans ce grand texte.
Extrait : « Guetteur d’ombre »
Dans une forêt vosgienne, un couple à trois et plus si affinités
« C’est pourtant bien simple, dit le garde, votre cerf est un cerf-page, tout simplement… Les Allemands appellent ça "beihirsch". Quand certains cerfs arrivent au sommet de leur force, ils sont rois, plus puissants que tous. Il leur suffit de se montrer pour faire céder le pas aux autres. Leurs hardes sont aussi nombreuses qu’ils le veulent, les femelles y viennent d’elles–mêmes. En même temps, leur humeur change, comme s’ils présentaient, derrière ces étés superbes, le temps du déclin, les fins d’hiver où leurs bois repousseront de plus en plus faiblement, ravaleront jusqu’à n’être que deux perches noueuses… Les derniers élans de sang les jetteront, non plus vers les femelles et les combats, mais dans les grandes errances qui précèdent la mort. Certains de ces animaux, avant d’entrer dans la solitude, cherchent un compagnon jeune, souvent très beau. Ils savent choisir celui qui sera digne de la succession. Ce page prend autorité sur la harde, et même la vieille biche se soumet à lui. Il vit avec l’interdiction absolue de toucher à une seule femelle… Bien sûr, même le vieux mâle ne sait pas toujours ce qui se passe au fond des fourrés, mais c’est tout à fait possible que cette interdiction soit respectée, parce que certains pages, bizarrement, paraissent tenir davantage à leur maître qu‘aux biches. Leur mission était de débarrasser le territoire des petits gêneurs, des maraudeurs à l’affût de l’occasion, et ils faisaient la police avec une grande vaillance, sans hésiter à s’attaquer à plus gros qu’eux, comme s’ils avaient à cœur de montrer leur courage, ou comme s’ils se sentaient soutenus sur leurs arrières. Ils bramaient comme des hérauts d’armes. Ce que le pacte leur donnait en échange était peu clair, l’occasion d’apprendre du vieux on ne sait quels secrets, d’avoir avec lui on ne sait quel partage, la récompense future de recevoir en héritage la harde, ou tout simplement la permission de vivre par passion dans l’ombre de celui qu’ils avaient choisi de servir… ».
Le défi du brame
 « Vous allez voir, on va le réveiller, le Monsieur ! ». Il avait soulevé le tapis de sol et dégageait le trou de passage absolument sans aucun bruit, avec une rapidité retrouvée. Il plongea le pied dans le vide à la recherche du premier échelon, et s’enfonça silencieusement. Le chasseur enjamba la trappe et continua debout, de surveiller les biches dont aucune n’était encore rentrée, puis mis la carabine à l’épaule et s’engagea à son tour dans le passage. A mi-corps, il fit surgir devant son visage le signe dessiné sur la paroi. C’était davantage une pupille et son iris qu’une cible. C’était un œil superposé à un trophée, un regard grand ouvert issu de ramures, et brusquement, l’oracle de ce blason lui apparut, sans qu’il eût à démêler si c’était un renoncement, un marché ou un présage. La vie du cerf était le garant de la vie du garde. Si les bois tombaient, l’œil se fermerait. Mais, cette balance n’avait de vérité que s’il s’acharnait à en rompre l’équilibre ; tant qu’il ferait tout pour tuer le cerf et que le cerf vivrait, le garde vivrait. Il était l’instrument de ce pacte, parce qu’il devait s’enrager à vaincre, et en même temps sa victime, parce qu’il fallait espérer que l’animal triompherait de lui. « Je suis complètement fou » se dit-il, pendant que l’idée de ce troc sauvage lui traversait, le temps d‘un éclair, pour laisser place à l’attention que demandait la descente silencieuse. Dès qu’il eut mis pied à terre, le garde s’avança vers les biches avec des précautions extrêmes, qu’il imita pas à pas, puis prirent insensiblement de la hauteur et s‘arrêtèrent entre deux buissons, au niveau d’une courte place très nue, presque rase, au-dessus de laquelle la falaise du fourré se dressait d‘un seul coup. Au-delà des broussailles, plus loin, les biches paissaient sur la pente. Il essaya sa lunette, il y voyait encore, c‘était bon. Le garde posa près de lui la lampe de poche et prit la corne de bœuf, dont la pointe avait été sciée pour former un porte-voix. « Bon, écoutez ! Je vais l‘appeler. Il risque d’arriver, raide comme balle… Attention, tirez dans le cou. Si vous n’avez pas le temps de tirer et qu’il nous fonce dessus, je l‘éblouirai avec la lampe. Alors là, vous vous débrouillerez… ». « Et si c’est le page ? » s’inquiéta le chasseur. « Ça m‘étonnerait que ce soit le page. Bon, on y va ? ». A genoux, le garde colla les coudes contre son corps, tint la corne sur sa poitrine et en approcha sa bouche en baissant la tête, contracté et serré sur lui–même. Il prit une longue inspiration et, d’un seul coup, un brame puissant, lugubre éclata sur la forêt, parti de sa gorge, amplifié par l’étroit pavillon de la corne qui semblait en rendre le ton plus grave et plus douloureux. Il y eut soudain un étrange silence, qui n’en finissait pas de reculer. Toutes les biches avaient levé la tête. Le garde avala sa salive et aspira ses lèvres pour les assouplir, puis lança un second mugissement, plus court, plus impérieux, et brusquement tout l‘arrière du fourré fut parcouru de manœuvres confuses. Loin derrière, vers les clairières, venait dans leur direction, un passage très rapide froissait les feuillages, longeait la lisière, puis changeait de route. A la hauteur du chemin du milieu, un grand tapage de branches parut dessiner un départ, qui ne vint pas. Le garde baissa de nouveau la tête, reprit son souffle et modula longuement un brame hautain, un cri de guerre terminé par trois impatients grondements de défi. Immédiatement, un galop de charge partit du haut, dévala droit sur eux et le cœur sonnant, il mit en joue l’espace nu qui le séparait du fourré. Mais l’assaut qui ravageait l’épaisseur du bois s’arrêta brutalement, comme s’il eut heurté un mur. Une seconde après, un rugissement terrifiant, déchirant, extraordinairement profond sonna à une quarantaine de mètres d‘eux, derrière les arbres, partit vers la vallée, revint en écho, recouvrit la forêt entière puis retentit immédiatement à nouveau, dans un long hurlement funèbre qui ricocha, lui aussi, en trois cris rauques, comme des râles très brefs. C’était si proche, si sauvage qu’il sentit le froid frémir sur sa peau, courir dans son dos, descendre en lui, puis il devint d’une dureté de glace, d’une sûreté et d’une maturité implacables. Il suffisait que l’autre sorte, et la balle irait se planter en lui, sans un centimètre d’écart. « Je suis en dessous de lui, murmura le garde en se frottant les lèvres. Je suis plus fort que le jeune, mais en dessous de celui-là. Allez-y bon Dieu, dit-il durement, qu’il sorte maintenant, qu’il sorte de là ! ». Il y eut encore une fuite beaucoup plus loin vers les broussailles, et une forme apparut sur la pente de la clairière au-dessus des biches. Instantanément, il identifia la stature sur laquelle un reste de lumière faisait luire un reflet de bronze. Les bois d’une symétrie parfaite avec de courtes fourchures dévoilaient le page aussi bien reconnaissable à son élan, à son allure téméraire. L’animal regardait de tous côtés, la tête dressée, puis démarra au grand trot vers les biches dont il fit le tour en les poussant violemment à coups d’andouillers vers le fourré, où il disparut avec elles. Toute la forêt craquait. La vielle biche, restée en lisière, hésita. Devant eux, le vieux cerf s’agitait en tempête et piétinait comme s’il eût foulé son ennemi, dans un grand fracas de rage. « Allez-y, supplia-t-il, appelez-le, qu’il sorte de là ! ». Le garde se ramassa tout entier et brama de toute sa force, mais sur une modulation différente, très caverneuse, où pouvaient se deviner la violence, la colère, l’offensive. Immédiatement, le cerf répondit. L’animal se déchaînait dans une sorte d’ivresse frénétique, et ils entendirent de grands coups sourds qui étaient le choc furieux de ses bois frappant les troncs d’arbres, puis les branches mortes ravagées par le piaffement des sabots et qui pétillaient comme un feu. Mais, il restait derrière la ligne des petits hêtres, invisible, ayant irrévocablement choisi son terrain. « Vous entendez ? » murmura le garde. « J’ai crié que j’étais le plus fort et il me répond : je suis le roi, c’est moi, c’est moi, c‘est moi… Il m‘offre le combat. « Alors, qu’est-ce qu’il fait ? ». « Qu’il sorte, bon sang ! Il m’offre de venir. J’ai bien peur qu‘il ne bouge pas de son territoire. Sa frontière doit passer là… ». « Je peux encore tirer, dit désespérément le chasseur, j’y vois très clair ». Plusieurs fois, le garde lança le cri de guerre, immédiatement réfuté par la tempête hargneuse du cerf qui continuait de prouver sa force et d’exhaler sa rage en assénant sur les troncs des coups de bûcheron. Dans la lunette, la ligne immobile des arbres était devenue plus sombre. Il sentit sur son épaule le poids d’une main. « Je n’en peux plus, souffla le garde. Plus de coffre, plus de gorge, plus rien… ».
« Vous allez voir, on va le réveiller, le Monsieur ! ». Il avait soulevé le tapis de sol et dégageait le trou de passage absolument sans aucun bruit, avec une rapidité retrouvée. Il plongea le pied dans le vide à la recherche du premier échelon, et s’enfonça silencieusement. Le chasseur enjamba la trappe et continua debout, de surveiller les biches dont aucune n’était encore rentrée, puis mis la carabine à l’épaule et s’engagea à son tour dans le passage. A mi-corps, il fit surgir devant son visage le signe dessiné sur la paroi. C’était davantage une pupille et son iris qu’une cible. C’était un œil superposé à un trophée, un regard grand ouvert issu de ramures, et brusquement, l’oracle de ce blason lui apparut, sans qu’il eût à démêler si c’était un renoncement, un marché ou un présage. La vie du cerf était le garant de la vie du garde. Si les bois tombaient, l’œil se fermerait. Mais, cette balance n’avait de vérité que s’il s’acharnait à en rompre l’équilibre ; tant qu’il ferait tout pour tuer le cerf et que le cerf vivrait, le garde vivrait. Il était l’instrument de ce pacte, parce qu’il devait s’enrager à vaincre, et en même temps sa victime, parce qu’il fallait espérer que l’animal triompherait de lui. « Je suis complètement fou » se dit-il, pendant que l’idée de ce troc sauvage lui traversait, le temps d‘un éclair, pour laisser place à l’attention que demandait la descente silencieuse. Dès qu’il eut mis pied à terre, le garde s’avança vers les biches avec des précautions extrêmes, qu’il imita pas à pas, puis prirent insensiblement de la hauteur et s‘arrêtèrent entre deux buissons, au niveau d’une courte place très nue, presque rase, au-dessus de laquelle la falaise du fourré se dressait d‘un seul coup. Au-delà des broussailles, plus loin, les biches paissaient sur la pente. Il essaya sa lunette, il y voyait encore, c‘était bon. Le garde posa près de lui la lampe de poche et prit la corne de bœuf, dont la pointe avait été sciée pour former un porte-voix. « Bon, écoutez ! Je vais l‘appeler. Il risque d’arriver, raide comme balle… Attention, tirez dans le cou. Si vous n’avez pas le temps de tirer et qu’il nous fonce dessus, je l‘éblouirai avec la lampe. Alors là, vous vous débrouillerez… ». « Et si c’est le page ? » s’inquiéta le chasseur. « Ça m‘étonnerait que ce soit le page. Bon, on y va ? ». A genoux, le garde colla les coudes contre son corps, tint la corne sur sa poitrine et en approcha sa bouche en baissant la tête, contracté et serré sur lui–même. Il prit une longue inspiration et, d’un seul coup, un brame puissant, lugubre éclata sur la forêt, parti de sa gorge, amplifié par l’étroit pavillon de la corne qui semblait en rendre le ton plus grave et plus douloureux. Il y eut soudain un étrange silence, qui n’en finissait pas de reculer. Toutes les biches avaient levé la tête. Le garde avala sa salive et aspira ses lèvres pour les assouplir, puis lança un second mugissement, plus court, plus impérieux, et brusquement tout l‘arrière du fourré fut parcouru de manœuvres confuses. Loin derrière, vers les clairières, venait dans leur direction, un passage très rapide froissait les feuillages, longeait la lisière, puis changeait de route. A la hauteur du chemin du milieu, un grand tapage de branches parut dessiner un départ, qui ne vint pas. Le garde baissa de nouveau la tête, reprit son souffle et modula longuement un brame hautain, un cri de guerre terminé par trois impatients grondements de défi. Immédiatement, un galop de charge partit du haut, dévala droit sur eux et le cœur sonnant, il mit en joue l’espace nu qui le séparait du fourré. Mais l’assaut qui ravageait l’épaisseur du bois s’arrêta brutalement, comme s’il eut heurté un mur. Une seconde après, un rugissement terrifiant, déchirant, extraordinairement profond sonna à une quarantaine de mètres d‘eux, derrière les arbres, partit vers la vallée, revint en écho, recouvrit la forêt entière puis retentit immédiatement à nouveau, dans un long hurlement funèbre qui ricocha, lui aussi, en trois cris rauques, comme des râles très brefs. C’était si proche, si sauvage qu’il sentit le froid frémir sur sa peau, courir dans son dos, descendre en lui, puis il devint d’une dureté de glace, d’une sûreté et d’une maturité implacables. Il suffisait que l’autre sorte, et la balle irait se planter en lui, sans un centimètre d’écart. « Je suis en dessous de lui, murmura le garde en se frottant les lèvres. Je suis plus fort que le jeune, mais en dessous de celui-là. Allez-y bon Dieu, dit-il durement, qu’il sorte maintenant, qu’il sorte de là ! ». Il y eut encore une fuite beaucoup plus loin vers les broussailles, et une forme apparut sur la pente de la clairière au-dessus des biches. Instantanément, il identifia la stature sur laquelle un reste de lumière faisait luire un reflet de bronze. Les bois d’une symétrie parfaite avec de courtes fourchures dévoilaient le page aussi bien reconnaissable à son élan, à son allure téméraire. L’animal regardait de tous côtés, la tête dressée, puis démarra au grand trot vers les biches dont il fit le tour en les poussant violemment à coups d’andouillers vers le fourré, où il disparut avec elles. Toute la forêt craquait. La vielle biche, restée en lisière, hésita. Devant eux, le vieux cerf s’agitait en tempête et piétinait comme s’il eût foulé son ennemi, dans un grand fracas de rage. « Allez-y, supplia-t-il, appelez-le, qu’il sorte de là ! ». Le garde se ramassa tout entier et brama de toute sa force, mais sur une modulation différente, très caverneuse, où pouvaient se deviner la violence, la colère, l’offensive. Immédiatement, le cerf répondit. L’animal se déchaînait dans une sorte d’ivresse frénétique, et ils entendirent de grands coups sourds qui étaient le choc furieux de ses bois frappant les troncs d’arbres, puis les branches mortes ravagées par le piaffement des sabots et qui pétillaient comme un feu. Mais, il restait derrière la ligne des petits hêtres, invisible, ayant irrévocablement choisi son terrain. « Vous entendez ? » murmura le garde. « J’ai crié que j’étais le plus fort et il me répond : je suis le roi, c’est moi, c’est moi, c‘est moi… Il m‘offre le combat. « Alors, qu’est-ce qu’il fait ? ». « Qu’il sorte, bon sang ! Il m’offre de venir. J’ai bien peur qu‘il ne bouge pas de son territoire. Sa frontière doit passer là… ». « Je peux encore tirer, dit désespérément le chasseur, j’y vois très clair ». Plusieurs fois, le garde lança le cri de guerre, immédiatement réfuté par la tempête hargneuse du cerf qui continuait de prouver sa force et d’exhaler sa rage en assénant sur les troncs des coups de bûcheron. Dans la lunette, la ligne immobile des arbres était devenue plus sombre. Il sentit sur son épaule le poids d’une main. « Je n’en peux plus, souffla le garde. Plus de coffre, plus de gorge, plus rien… ».
