En mai et juin 1940, il se battra avec abnégation pour contenir la percée des Allemands. Les revers militaires n’abattent pas ce général mis en retraite forcée. En 1942, il héberge dans sa propriété le général Giraud, puis rallie l’Algérie via l’Espagne, pour rejoindre le combat. Las des bisbilles politiques du nid d’aspics qu’est Alger, il se bat anonymement, général sans étoile, avec les troupes du général Juin, qui l’élèvera à la dignité de soldat de 1ère classe au sein du 3e Régiment des Tirailleurs Algériens, avant d’apprendre sa véritable identité. Membre de l’état-major du général de Lattre, René Chambe est dans les premières vagues qui débarquent en Provence. Le général Chambe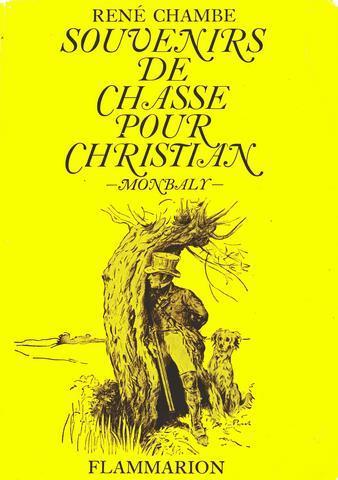 terminera sa carrière militaire en Allemagne. Il fut élevé à la dignité de Grand-croix de la Légion d’Honneur. C’est alors que s’ouvre pour lui, après la carrière du soldat, celle de l’écrivain. Sa retraite permet à ce chasseur invétéré de dépeindre par les mots les chasses en montagne, et surtout les souvenirs de sa jeunesse. Nous n’évoquerons pas ses ouvrages tirés de son expérience de sa vie militaire et d’aviateur et oublions son premier roman « Le bracelet d’ébène » qui met en scène des officiers français et allemands dans un décor d’espionnage en Méditerranée.
terminera sa carrière militaire en Allemagne. Il fut élevé à la dignité de Grand-croix de la Légion d’Honneur. C’est alors que s’ouvre pour lui, après la carrière du soldat, celle de l’écrivain. Sa retraite permet à ce chasseur invétéré de dépeindre par les mots les chasses en montagne, et surtout les souvenirs de sa jeunesse. Nous n’évoquerons pas ses ouvrages tirés de son expérience de sa vie militaire et d’aviateur et oublions son premier roman « Le bracelet d’ébène » qui met en scène des officiers français et allemands dans un décor d’espionnage en Méditerranée.
« Ta chasse, toujours ta chasse… »
René Chambe magnifie surtout la chasse en territoire alpestre, dans sa région de naissance ou gîte un gibier mythique, le tétras. Monbaly, château de sa famille, est le cadre de ses souvenirs. C’est également le terroir de ses textes « Souvenirs ». On a 10/12 ans, toutes les peurs au ventre et toutes les audaces dans les jambes, au point de subir l’algarade maternelle. « Dans la grande salle à manger où les lampes sont depuis longtemps allumées, mon entrée est saluée de diverses manières. Notre mère nous reçoit plutôt fraîchement. « Ah, te voilà, petit malheureux ! Ta chasse, toujours ta chasse ! Mais qu’as-tu fait tout ce temps ? ». Chaque adulte a l’épaisseur d’un personnage de roman, qu’il vous initie aux mystères des cartouches à poudre noire, ou aux charmes de la passée des canards. Il devient un demi-dieu, comme certains artistes du miroir aux alouettes qui alignaient 177 oiseaux en une matinée. Avant 1914, il fallait se contenter de deux diplômes bien suffisants : le « certif » et le permis de chasser. Avec ces deux sésames, la vie s’ouvrait devant vous. Dans propos d’un vieux chasseur de coqs, Chambe nous entraîne dans la chasse sportive. Dix-huit kilomètres de marche, de côtes bien raides pour grimper d’Aime à La Plagne. C’était bien avant les aménagements touristiques qui ont réduit l’habitat de ce gibier royal. « Le coq de bruyère exècre l’abomination destructrice de la beauté, de la nature, de sa grandeur et de son, silence… Tout y est grand, tout y est pur… Les effluves de la divaria, cet air pur des Alpes avec ses senteurs de fleurs et parfums d’abîmes, qui, selon Alpinus, porte à la griserie des sens et à l’euphorie spirituelle… Le chasseur évoque ses coups de fusil, car la beauté du tir prime sur la quantité du tableau… Un lièvre et 4 coqs, que grâce soit rendu à Saint Hubert ».
Monbaly, le grenier des souvenirs
Aussi, il parcourt les estives livrées aux bergers, « qui débitent à la hache, à compter du mercredi, le pain de la semaine monté le dimanche ». C’est un dialogue au milieu des touffes d’arcoses et il n’entend plus le brouhaha du monde moderne qui ravage la vallée. Il regrette cette vie patriarcale et confesse que « le ver luisant n’avait plus rien à faire au siècle de l’électricité ». Pour lui, le face à face avec le coq est presque aussi puissant que le combat aérien. « … et voici, au-dessus de moi, le fracas caractéristique du coq qui se lève, le fracas terrible, qui, quoiqu’on fasse, vous sèche toujours le sang dans les veines, même quand on prétend être devenu blindé et placide. Presque aussitôt, deux coups de fusils l’un sur l’autre. Pan, pan ! On croit que le coq est mort, mais aussitôt, deux coups en arrière-plan. Pan, pan ! Est-ce l’écho ? Quelle fusillade, le coq est mort, c’est sûr, pas besoin de l’attendre. Mais quoi, c’est fou, le voilà intact, franchissant la crête, la ligne de changement de pente. Comme un bolide noir et blanc, il me passe si près que je vois la grosse fraise écarlate de son sourcil. Quelle magnifique lyre… Dix-huit illustrations de Xavier du Poret rythment ainsi la narration de ce beau texte. Monbaly, le grenier aux souvenirs de René Chambe ouvre toutes ses portes dans « Souvenirs de chasse pour Christian ». Douze chapitres, tout en gags, zig-zag, pleins de sève et de vie comme ces jours tranquilles où les pétoires de chasse se chargeaient par 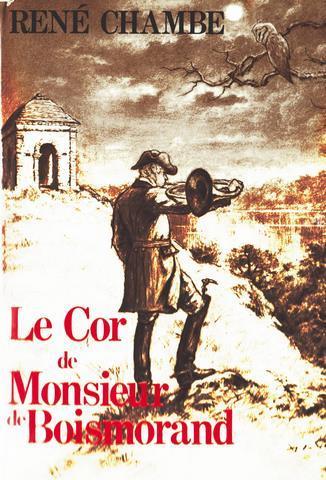 le bout de canon. Mais toujours le respect du gibier : « Je ne l’ai jamais vu manquer un coup de fusil, tu entends, pas un seul ! On te dira qu’il ne tirait qu’à coup sûr… Peut-être… ». Il refusait de tirer dans de mauvaises conditions : « à quoi sert de blesser du gibier ? Vous ne verrez pas où il va tomber. Vous le perdrez et vos chiens s’y perdront le nez. Laissez-le courir, vous le retrouverez… A quoi ça sert de tirer de trop près ? Vous manquerez ou vous abîmez le gibier, surtout la caille… ça tue loin quand même un Lefaucheux avec de la surfine… ».
le bout de canon. Mais toujours le respect du gibier : « Je ne l’ai jamais vu manquer un coup de fusil, tu entends, pas un seul ! On te dira qu’il ne tirait qu’à coup sûr… Peut-être… ». Il refusait de tirer dans de mauvaises conditions : « à quoi sert de blesser du gibier ? Vous ne verrez pas où il va tomber. Vous le perdrez et vos chiens s’y perdront le nez. Laissez-le courir, vous le retrouverez… A quoi ça sert de tirer de trop près ? Vous manquerez ou vous abîmez le gibier, surtout la caille… ça tue loin quand même un Lefaucheux avec de la surfine… ».
De tout poil et de toutes races
Retenons en final le délicieux ouvrage : « Le cor de Monsieur de Boismorand ». Se niche à l’intérieur de ces souvenirs une nouvelle fantasmagorique où ressuscite la glorieuse phalange des veneurs héritiers des Foudras, des Mac Mahon et de son piqueur Racot qui chassaient loups et sangliers à en perdre haleine. Lisez aussi la très cocasse chasse au lièvre, rescapé d’un accident de la route qui s’évade du coffre de la voiture assassine, pour se dégourdir les jarrets sur les Champs–Elysées. Qu’est qu’un chasseur sans chien ? Un vulgaire tireur ! Chambe ressuscite la vie des chiens qui l’ont accompagné. « Il est impossible d’aimer les chiens plus que je les ai aimés ». De tout poil, de toute race, tel Zoum, un superbe setter irlandais, ou Djerba ainsi baptisée pour sa naissance en Algérie. Elle l’accompagnera durant la campagne d’Italie, sera nourrie aux rations « K » de l’armée américaine et sera le seul chien admis à débarquer sur le sol de Provence. Puis, d’autres compagnons, sélectionnés chez les Korthal ou les Munsterländer. Tous chiens d’arrêt brillants, fous de chasse. Mais aussi un mot pour les sans-grades, Tambelle et Sans-Peur, deux corniauds sans origine connue, sans armoiries dans leurs familles… Les corniauds chassent tout. Ils luttent de vitesse, à toutes jambes avec leur maître, pour arriver avant lui sur la pièce de gibier tombée et avoir le temps de la houspiller à grands coups de nez. Ces chiens de roture très rusés vous lèveront le coq que le pointer, chien héraldique, bloqué dans son arrêt n’aura pu débusquer. Il décline dans ses récits de chasse, l’amour déférent de la nature, le respect du gibier et la passion pour son chien. Grand Prix littéraire de la chasse, René Chambe mérite d’être lu et relu.
Extrait
Portraits et saynètes d’un temps passé
Chambe a su capter les sons des respirations des vieilles armoires, les odeurs des herbes médicinales récoltées, les fantômes des portraits qui glissent de leur cadre, le long des couloirs des demeures de notre enfance. Les râteliers d’armes sont les mémoires de nos chasseurs d’antan
Commençons par le portrait du Père David. Le père David était resté bien longtemps chasseur de loups. Au milieu du siècle, il se trouvait encore des loups à l’état sédentaire dans les fourrés de Biaune, de Four, des Ayes et de Montjat. Mais, par des hivers rigoureux, il en arrivait de plus nombreux, sortis des massifs du Vercors et de la Chartreuse, poussés par la faim. Les loups disparus, le père David s’était rabattu sur des seigneurs de moindre importance, les sangliers d’abord et les chevreuils, puis les lièvres et les lapins, et ensuite comme tout le monde, sur le seul gibier restant, c’est-à-dire sur les perdrix, les rois des cailles, les cailles et les grives. Il avait ainsi descendu, un par un, les degrés de l’escalier du chasseur. Aujourd’hui, devenu vieux, il se retrouvait assis tristement sur la dernière marche. Il était devenu tireur de becfigues. Son premier permis de chasse, on disait alors port d’armes, était daté de 1830. Chez lui, dans un châssis vitré que le père David vient justement d’ouvrir, il sortait des petites bouteilles plates qui contenaient de la poudre noire. C’est avec cela qu’il faisait ses cartouches. Elles étaient habillées d’une étiquette les recouvrant presque en entier, avec des tas d’indications et de recommandations en petites lettres rouges qu’on ne lisait jamais. Et tous ces petits sacs en toile grossière, marqués d’un grand numéro noir : 4, 5, 7, 8, 10, 2, 1… remplis de plombs de chasse. Plus les numéros étaient forts, plus le plomb était petit. Le père David l’avait expliqué, tout en critiquant cette inopportune mesure : « c’est idiot, ça ne veut rien dire ! ça fait tromper les gens… ». Il y avait encore de grands sacs de papier beige contenant des bourres, soi-disant en feutre, mais faite de vulgaire aggloméré de poils de lapin écrasés entre deux rondelles de papier. « Ce que c’est que le progrès, disait le père David. C’est une idiotie ! ça ne vaut rien, ces trucs-là. Moi je me sers toujours du papier du Nouvelliste de Lyon… J’ai soixante-neuf ans d’expérience. Il a un fameux papier, le Nouvelliste… ». Armé de son vieux fusil, celui qui ne l’avait jamais quitté, sanglé de sa poire à poudre, de son sac à plombs, une feuille du Nouvelliste de Lyon, édition de l’Isère dans la poche, il arrivait à son poste quand le soleil était déjà assez haut pour avoir bu la rosée du matin. Il lui fallait, à présent, charger la chère vieille pétoire. Ah ! nous le connaissions bien ce fusil de 1830 à crosse de merisier. Nous l’avions baptisé de ce nom étrange et inattendu : pot-de-beurre. En voici l’origine : nous regardions le père David verser dans chacun des canons, et avec la minutie d’un vieux trappeur, la ration réglementaire de poudre noire. « Qu’est-ce que vous faites, père David ? » demandions nous. « C’est pour Messieurs les becfigues. Je leur prépare de la bonne cuisine. Vous voyez, je leur verse d’abord un peu de beurre (il prononçait po de beurre) et par-dessus quelques beaux grains de poivre. Ça va être fameux ! » répondait-il. Les grains de poivre, c’était la cendrée, le plomb de Lyon n°12, ce qui se faisait de plus petit. Le père David bourrait ensuite, à l’aide de la baguette, quelques lambeaux du Nouvelliste arrachés et mis en boule, sans égard pour la prose des rédacteurs. Il armait les deux chiens (tac, tac), et habillait enfin chacune des cheminées d’une belle capsule à chemise de cuivre. Tout était bien, Il n’y avait plus qu’à attendre.
Marquette et son fusil qu’à un coup
« Pourquoi mon fusil, il n’a qu’un coup ? C’est parce que c’est le meilleur, et je vas vous dire pourquoi c’est mauvais d’en avoir deux, de coups. Si vous en avez deux, vous tirez vite le premier parce que vous dites que ça n’a pas d’importance, puisque vous en avez un deuxième. Alors vous tirez vite et souvent au hasard, et vous manquez. Alors, vous vous affolez d’avoir manqué et pour vous rattraper, vous tirez encore plus vite le second. Et vous manquez encore, d’autant plus sûr que le gibier il est plus loin ».
Marquette se dirigeait vers les derniers peupliers, à la queue de l’étang. Là, selon le vent qui avait donné dans la journée, il en choisissait un de la rangée regardant le levant, ou au contraire de la rangée d’en face, regardant le couchant. Alors il s’arrêtait, observait, restait un moment immobile, l’oreille tendue comme un animal des bois aux aguets, puis rassuré, il sortait de son immobilité de pierre, ajustait la bretelle de son fusil et celle de sa musette, croisées sur sa poitrine. Un dernier coup d’œil autour de lui et hop, avec une agilité d’écureuil, il se hissait à la force des bras et des genoux le long du tronc du peuplier. Il s’élevait ainsi de six à huit mètres. Arrivé à la hauteur voulue, Marquette soufflait, tirait de sa veste une longueur de grosse corde à lessive, se la passait sous les cuisses, puis en nouait les deux bouts de l’autre côté du tronc. Après quoi, il s’asseyait sur ce siège précaire, les pieds calés dans les branches. De son poste, il survolait l’étang. Marquette était un homme libre, formidablement libre, suspendu entre ciel et terre. Aussi heureux que lui, le chien Vazi connaissait depuis longtemps la manœuvre. Non, Vazi ne broncherait pas, ne trahirait pas la présence de son maître. Ah, les belles nuits de septembre et d’octobre, à l’époque des grands passages. Mais que chassait Marquette ? Tout le gibier d’eau et rien que le gibier d’eau. Marquette mangeait toutes les variétés de râles, ceux à bec rouge, ceux à bec blanc. Il mangeait jusqu’aux mouettes pèlerines, jusqu’aux hérons cendrés et même les abominables butors. Quelqu‘un lui avait demandé : « Comment pouvez-vous manger les butors, cette saleté. Ça empoisonne l’huile rance et le poisson ! ». Il avait rétorqué, en riant, découvrant ses dents pointues de renard ou de loutre : « Ben quoi, c’est tout profit. Comme ça, on mange à la fois de la volaille et du poison ». Il jetait sans façon les ossements par terre, à côté de sa chaise, à l’attention de son chien Vazi. Mais le chien Vazi ne poussait pas l’admiration ni la fidélité à l’égard de son maître jusqu’à se croire obligé de partager ses goûts vulgaires. Il pignochait, choisissait avec méfiance dans les débris de la manne tombée de l’assiette patronale, opérant sans jamais se tromper, le tri du noble d’avec le commun. Il croquait avec délices les os de canards, les carcasses de bécassines ou de pluviers, mais n’hésitait pas, comme le font tous les chiens du monde, à exprimer sa désapprobation autant que son dégoût, en se roulant les quatre pattes en l’air, sur les reliefs odorants des mouettes, des plongeons ou des hérons. Pour les butors, la démonstration était plus expressive encore. Elle s’achevait par un paragraphe sans équivoque, une signature d’un dédain majuscule, dans le plus style, la patte gracieusement levée. Le cas Marquette ne pouvait intéresser que les gendarmes. Or en France, le rôle du gendarme est l’un des plus importants. Songe qu’il est le premier de tous les échelons à rendre la justice. Sage et clairvoyant, il est tout à la fois un juge et un diplomate. Il est le premier maillon, donc le plus précieux de la longue chaîne de la hiérarchie sociale. Les gendarmes de la Verpillière n’avaient aucune raison de troubler les innocentes distractions d’un aussi pacifique paroissien. Ils attendaient sans doute que les intéressés, les canards ou les sarcelles, portassent plainte. Quand le vent sautait au Midi, soufflant avec violence, portant l’écho jusqu’à la lointaine Verpillière, c’était au tour du maréchal des logis de gendarmerie, commandant la brigade, de scruter l’obscurité, assis sur son séant, tandis que geignait son épouse. « Qu’est-ce que tu écoutes encore ? ». Au deuxième coup, le maréchal des logis n’y tenait plus. Il se levait et allait en chemise ouvrir grand la fenêtre. « Tu me fais geler ! » geignait plus fort la femme, toujours endormie. Mais au troisième coup, le même sourire complice que celui des habitants de Belmont effleurait la face du sous-officier. « Ce n’est rien. Ça vient de l’Etang des Trois eaux. C’est Marquette… ».
