Comme le soulignent les autrices de l’étude, Élisabeth Bro et Véronique de Billy (OFB), « il n’y a pas une méthanisation, mais des méthanisations », dont les impacts varient selon la taille des installations, le type d’intrants, la gestion des cultures et les pratiques agricoles locales. Les scientifiques appellent donc à poursuivre les recherches pour évaluer les effets sur le long terme, mais aussi sur d’autres aspects encore peu étudiés, comme les pollutions lumineuses ou sonores autour des unités de méthanisation, ou encore la dissémination potentielle de plantes envahissantes. En parallèle, des outils de surveillance écologique doivent être mis en place pour suivre l’évolution de la biodiversité autour des installations. 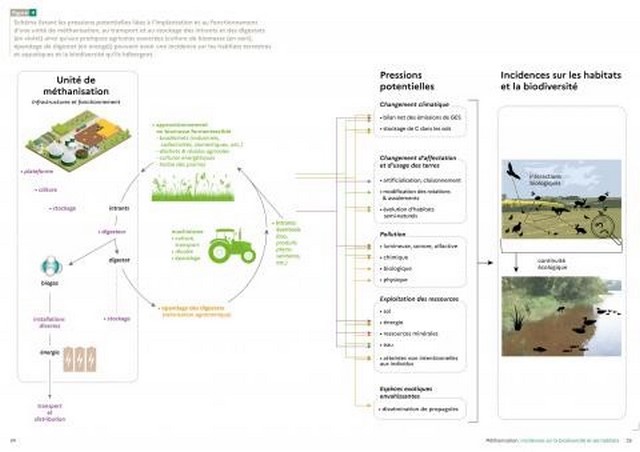 L’OFB ne se contente pas de pointer les risques, il propose aussi des recommandations très concrètes pour limiter les impacts :
L’OFB ne se contente pas de pointer les risques, il propose aussi des recommandations très concrètes pour limiter les impacts :
- diversifier les cultures, éviter le tout-maïs, et maintenir des habitats semi-naturels comme les haies ou les prairies ;
- adapter les dates de récolte pour ne pas déranger les périodes sensibles de la faune sauvage ;
- maîtriser l’épandage des digestats, en fonction du type de sol et des conditions météo ;
- limiter l’artificialisation des sols, en favorisant des implantations sur des terres déjà utilisées plutôt que sur des milieux naturels ;
- former les porteurs de projets et les agriculteurs pour intégrer la biodiversité dans les réflexions dès la conception des unités.
Sans condamner la méthanisation, l’étude de l’OFB souligne la nécessité d’un encadrement plus fin, d’une planification territoriale cohérente, et d’une meilleure prise en compte des enjeux écologiques, car produire une énergie locale et renouvelable ne doit pas se faire au détriment du vivant. La transition écologique, pour être crédible, doit être globale, c’est-à-dire bénéfique à la fois pour le climat et pour la biodiversité.
