« Cheval, mon bel ami Sfax »
 « Avec Sfax, j’étais passé d’un monde à l’autre. De celui limité des hommes, à celui des bêtes, et qui, la frontière franchie, n’en forme plus qu’un seul à la mesure de tout ce qui respire et de tout ce qui vit ». Premier cheval de Paul Vialar, Sfax, avec sa force naturelle est donc l’ambassadeur qui nous fait entrer dans le monde de la chasse et de la nature. Le monde des courses lui apprendra l’intransigeance dans le détail, la rigueur, le sérieux pour servir le cheval, ce seigneur… On peut lire « La grande meute » comme une allégorie du mythe d’Actéon. La meute dévore à pleines dents Lambrefault, comme la meute de ses créanciers dévore ses fermes et ses bois. «… un instrument comme celui que votre voisin a mis au point, au prix de tant de sacrifices… est une manière de Stradivarius. Il ne suffit pourtant pas qu’il soit d’une qualité exceptionnelle, il faut encore un virtuose pour en jouer… ». C’est l’époque bancale de l’entre-deux-guerres, quatorze ans de lente descente aux enfers. Le monde de Lambrefault sombre trop doucement pour qu’une révolution soit rapide. On invite le baron von Ott, aristocrate allemand d’origine prussienne, mais il est encore trop tôt pour que la réconciliation avec l’ancien ennemi héréditaire soit possible. Cependant, il saisit parfaitement la réussite parfaite de cette meute, équilibre délicat de sangs dosés, de pyramide des âges, de complémentarité des chiens de haut nez. Mais il faut adapter l’équipage aux nouveaux besoins. Par le feu des enchères de l’adjudication, il se transforme d’entité personnelle confondue avec Lambrefault, en club-société. « Il est déjà assez beau que M. de Lambrefault nous fasse l’hommage de sa meute et de son équipage. Offrons-lui le territoire… ». Mais trop de passion déchaîne des puissances obscures et maléfiques. Sa femme Agnès devient la femme stérile qui sombre dans la folie initiée par la chasse, la vision du maître d’équipage qui étreint jusqu’à la mort, sous les balles allemandes, sa dernière lice.
« Avec Sfax, j’étais passé d’un monde à l’autre. De celui limité des hommes, à celui des bêtes, et qui, la frontière franchie, n’en forme plus qu’un seul à la mesure de tout ce qui respire et de tout ce qui vit ». Premier cheval de Paul Vialar, Sfax, avec sa force naturelle est donc l’ambassadeur qui nous fait entrer dans le monde de la chasse et de la nature. Le monde des courses lui apprendra l’intransigeance dans le détail, la rigueur, le sérieux pour servir le cheval, ce seigneur… On peut lire « La grande meute » comme une allégorie du mythe d’Actéon. La meute dévore à pleines dents Lambrefault, comme la meute de ses créanciers dévore ses fermes et ses bois. «… un instrument comme celui que votre voisin a mis au point, au prix de tant de sacrifices… est une manière de Stradivarius. Il ne suffit pourtant pas qu’il soit d’une qualité exceptionnelle, il faut encore un virtuose pour en jouer… ». C’est l’époque bancale de l’entre-deux-guerres, quatorze ans de lente descente aux enfers. Le monde de Lambrefault sombre trop doucement pour qu’une révolution soit rapide. On invite le baron von Ott, aristocrate allemand d’origine prussienne, mais il est encore trop tôt pour que la réconciliation avec l’ancien ennemi héréditaire soit possible. Cependant, il saisit parfaitement la réussite parfaite de cette meute, équilibre délicat de sangs dosés, de pyramide des âges, de complémentarité des chiens de haut nez. Mais il faut adapter l’équipage aux nouveaux besoins. Par le feu des enchères de l’adjudication, il se transforme d’entité personnelle confondue avec Lambrefault, en club-société. « Il est déjà assez beau que M. de Lambrefault nous fasse l’hommage de sa meute et de son équipage. Offrons-lui le territoire… ». Mais trop de passion déchaîne des puissances obscures et maléfiques. Sa femme Agnès devient la femme stérile qui sombre dans la folie initiée par la chasse, la vision du maître d’équipage qui étreint jusqu’à la mort, sous les balles allemandes, sa dernière lice.
Entre chien et cheval
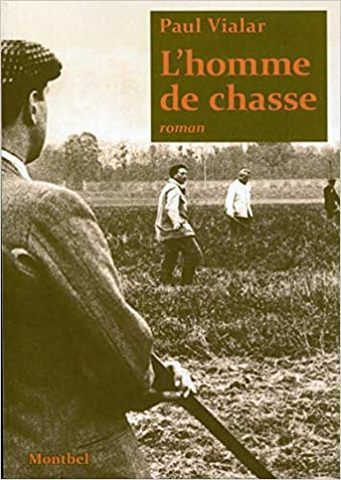 Ce roman est une introduction romanesque au monde de la vènerie, de l’élevage à la création des meutes spécialisées sur le lièvre, le cerf ou la bête noire. Le lecteur vibre comme un valet de limier qui cherche à se mettre sous le vent pour en goûter tous les plaisirs. Mais c’est surtout un hymne complet au chien. « Je ne pouvais pas partir sans dire adieu aux chiens… Oh, à vous aussi bien entendu… Les regards des deux hommes se croisèrent. Ils y lurent une telle compréhension, un tel amour des mêmes choses, qu’il était presque inutile que Marvault expliquât… ». C’est toujours le chien ou le cheval qui sert de pont entre ces mondes visibles et invisibles. Aussi, le bibliophile recherchera l’édition de luxe avec les eaux-fortes de P-Y Trémois. Il y a bien plus de mystère sur le papier que dans l’adaptation cinématographique, trop fade, de « La grande meute », pas assez couillue disait l’auteur. Heureusement, ce roman fut un lieu de découverte et d’initiation à la chasse et à la vènerie pour de nombreuses générations, car au bout de la vie du chasseur, il y a le dépassement ultime où il se fond dans sa passion. « La vie qui a un but, la vie vivante comme disait Matthieu, joie de l’oreille, de la vue, tour de force chaque jour renouvelé, jeu magnifique auquel on croit, pour lequel on mourrait au besoin d’un heurt de branche au front, d’une chute dans un ravin, d’un coup de sang d’avoir trop gueulé, d’une faiblesse d’être arrivé au bout de ses poumons… ». Quelle belle synthèse de l’acte de chasse ! Mais les temps sont durs et ingrats. Les romans cynégétiques sont aussi la description d’une France en mutation. Mehlen, dans « La chasse aux hommes » est un tycoon qui tire les ficelles jusque dans les ministères. Mais pour quel résultat ?
Ce roman est une introduction romanesque au monde de la vènerie, de l’élevage à la création des meutes spécialisées sur le lièvre, le cerf ou la bête noire. Le lecteur vibre comme un valet de limier qui cherche à se mettre sous le vent pour en goûter tous les plaisirs. Mais c’est surtout un hymne complet au chien. « Je ne pouvais pas partir sans dire adieu aux chiens… Oh, à vous aussi bien entendu… Les regards des deux hommes se croisèrent. Ils y lurent une telle compréhension, un tel amour des mêmes choses, qu’il était presque inutile que Marvault expliquât… ». C’est toujours le chien ou le cheval qui sert de pont entre ces mondes visibles et invisibles. Aussi, le bibliophile recherchera l’édition de luxe avec les eaux-fortes de P-Y Trémois. Il y a bien plus de mystère sur le papier que dans l’adaptation cinématographique, trop fade, de « La grande meute », pas assez couillue disait l’auteur. Heureusement, ce roman fut un lieu de découverte et d’initiation à la chasse et à la vènerie pour de nombreuses générations, car au bout de la vie du chasseur, il y a le dépassement ultime où il se fond dans sa passion. « La vie qui a un but, la vie vivante comme disait Matthieu, joie de l’oreille, de la vue, tour de force chaque jour renouvelé, jeu magnifique auquel on croit, pour lequel on mourrait au besoin d’un heurt de branche au front, d’une chute dans un ravin, d’un coup de sang d’avoir trop gueulé, d’une faiblesse d’être arrivé au bout de ses poumons… ». Quelle belle synthèse de l’acte de chasse ! Mais les temps sont durs et ingrats. Les romans cynégétiques sont aussi la description d’une France en mutation. Mehlen, dans « La chasse aux hommes » est un tycoon qui tire les ficelles jusque dans les ministères. Mais pour quel résultat ?
Le rêve est dans l’action
« Où était-il le temps, le beau temps, celui qu’il appelait le temps normal où les hommes tels que lui n’avaient pas les sordides préoccupations de maintenant ? Il ressemblait à quelque chose d’un peu humiliant à ce monnayage… ». Ces lignes tirées de « L’invité de chasse » relève l’impuissance de ne pouvoir tout monnayer. Le chasseur doit se mettre humblement à l’école de la chasse. Vialar, dès les années 1950, pourtant en pleine période euphorique de la chasse, plaide déjà pour une gestion raisonnée et raisonnable de la nature. « Vraiment, il devrait y avoir des écoles de chasse. On ne devrait délivrer le permis qu’à des gens qui connaissent le rudiment de cet art, qui est presque une science. Tout le monde y aurait à gagner… » plaide M. de Talagnac, dans la page 219. Dans le même ouvrage, Paul Vialar dresse une série de portraits porte-parole. Chacun donne ainsi une vision de la chasse face à l’inspecteur de police Chamoy, qui, pour mieux les faire parler, tait ses compétences cynégétiques. Chasse à multiples facettes qui révèle le profond de chaque être. « A la chasse, le rêve est dans l’action… ». Par l’intermédiaire de Vialar, continuons donc de rêver et continuons d’agir pour le maintien de notre passion. Que ces lectures vous accompagnent…
Extrait : Servir un sanglier à l’épieu
Il n’y avait pas un souffle de vent et une brume transparente stagnait à la hauteur des épaules…
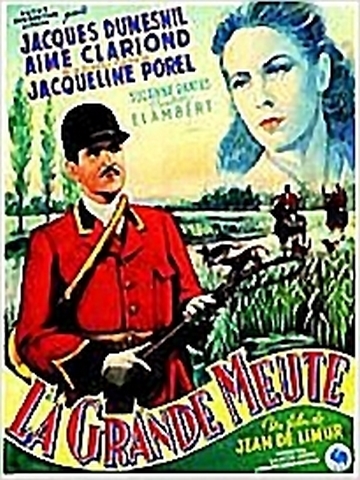 Un oiseau la trouait parfois, sitôt disparu, ricochant sur le silence comme une pierre noir jetée par une main invisible. Il devait y avoir là–haut, tout près et pourtant si loin, un soleil ardent que l’atmosphère dense tamisait, rendait irréel. Ils étaient à pied, à présent, tous les deux dans l’allée ; ils avançaient sans faire de bruit, en parlant à voix basse, malgré qu’ils fussent à contre vent, pour ne pas alerter les bêtes. Côme disait : « Il y a une laie et ses petits et aussi un mâle, un vrai lourd et trapu avec eux. Mathieu les a vu hier, au moment où ils plongeaient derrière le taillis du Loup. Ils n’ont pas bougé de la nuit : mes hommes ont fait l’enceinte et n’ont trouvé que les traces d’entrée. Ils ont du gland, du reste, cela suffit à les tenir. La laie et les petits ont dû aller aux fouges faire leurs bouttis, ce qui, veut dire pour vous profane, chercher sous la terre des racines de fougères. Le mâle lui a dû s’embauger après s’être rembuché. Vous me laisserez faire… ». « Ce n’est pas une chasse que l’on peut se permettre quand on n’y est pas entraîné ». Il serrait l’épieu dans sa main et Marvault se penchait pour regarder l’arme que Côme lui présentait. M. de Lambrefault expliquait : « les bonnes lames doivent avoir, comme celle-ci, la saignée en forme de feuille de sauge ; la pointe ne doit pas en être ni trop large ni trop faible, de façon que, si par malheur le coup ne porte pas exactement au bon endroit, entre l’oreille et l’épaule et qu’elle rencontre la hure ou l’os de la mâchoire, elle ne se casse ni ne s’émousse. Elle doit être assez longue, car elle doit parvenir jusqu‘au cœur. Bien placée, elle doit entrer jusqu’à la billotte. Voyez le manche ; il faut qu’il soit gros qu’on puisse le tenir à plein poing ; il doit être de frêne, de pommier sauvage, d’érable ou d’épine noire. La billotte doit être attachée de cuir de bœuf ou de cheval le plus résistant que l’on puisse trouver… Je fais également entortiller le manche – la hante – de bon cuir que je fais clouer tout le long, les bandes en sont tournées et entortillées à trois ou quatre doigts l’une de l’autre de façon que si dans le choc la hante vient à se briser, les éclats tiennent ensemble… Il faut que tout soit assez fort pour soutenir le choc d’une masse de deux cents livres pour le moins lancée au galop. Mais voyez-vous, Marvault, quel que soit le danger que l’on court, il y a là une minute étonnante, celle où la bête se décide de charger. Alors je l’attends, le genou de la jambe qui avance plié, l’autre jambe tendue en arrière, le plus loin possible. Je tiens mon arme fort court dans la main droite, j’appuie mon autre main sur ma hanche, je suis là comme un escrimeur le genou de ma jambe de devant servant de charnière à tout mon corps et me permettant sans autre mouvement d’ajuster mon coup. Car on n’en peut donner qu’un seul et encore faut–il que ce soit à la bonne place, à trois doigts près, entre l’oreille et l’épaule. Il faut attendre le choc et ne pas aller au-devant, demeurer bien solide, la jambe de derrière bien arrêtée en terre pour pouvoir le soutenir, garder toutes ses forces bien unies pour que l’animal furieux vienne s’enferrer sans rémission. A ce moment, il y a deux façons de porter le coup : entre le corps et l’épaule, de manière à soulever celle-ci et à enlever toute puissance à la bête de ce côté, mais le coup n’est pas beau car l’animal ne meurt pas subitement, ou bien plonger l’épieu en plein corps. Le heurt, dans ce cas, est bien plus rude, le danger plutôt passé. Touché jusqu’au cœur, l’arme enfoncée jusqu’à la bilotte, l’animal laisse jaillir son sang d’un jet comme le bras, il perd ses forces aussitôt et tombe aux pieds de l’enferreur … ».
Un oiseau la trouait parfois, sitôt disparu, ricochant sur le silence comme une pierre noir jetée par une main invisible. Il devait y avoir là–haut, tout près et pourtant si loin, un soleil ardent que l’atmosphère dense tamisait, rendait irréel. Ils étaient à pied, à présent, tous les deux dans l’allée ; ils avançaient sans faire de bruit, en parlant à voix basse, malgré qu’ils fussent à contre vent, pour ne pas alerter les bêtes. Côme disait : « Il y a une laie et ses petits et aussi un mâle, un vrai lourd et trapu avec eux. Mathieu les a vu hier, au moment où ils plongeaient derrière le taillis du Loup. Ils n’ont pas bougé de la nuit : mes hommes ont fait l’enceinte et n’ont trouvé que les traces d’entrée. Ils ont du gland, du reste, cela suffit à les tenir. La laie et les petits ont dû aller aux fouges faire leurs bouttis, ce qui, veut dire pour vous profane, chercher sous la terre des racines de fougères. Le mâle lui a dû s’embauger après s’être rembuché. Vous me laisserez faire… ». « Ce n’est pas une chasse que l’on peut se permettre quand on n’y est pas entraîné ». Il serrait l’épieu dans sa main et Marvault se penchait pour regarder l’arme que Côme lui présentait. M. de Lambrefault expliquait : « les bonnes lames doivent avoir, comme celle-ci, la saignée en forme de feuille de sauge ; la pointe ne doit pas en être ni trop large ni trop faible, de façon que, si par malheur le coup ne porte pas exactement au bon endroit, entre l’oreille et l’épaule et qu’elle rencontre la hure ou l’os de la mâchoire, elle ne se casse ni ne s’émousse. Elle doit être assez longue, car elle doit parvenir jusqu‘au cœur. Bien placée, elle doit entrer jusqu’à la billotte. Voyez le manche ; il faut qu’il soit gros qu’on puisse le tenir à plein poing ; il doit être de frêne, de pommier sauvage, d’érable ou d’épine noire. La billotte doit être attachée de cuir de bœuf ou de cheval le plus résistant que l’on puisse trouver… Je fais également entortiller le manche – la hante – de bon cuir que je fais clouer tout le long, les bandes en sont tournées et entortillées à trois ou quatre doigts l’une de l’autre de façon que si dans le choc la hante vient à se briser, les éclats tiennent ensemble… Il faut que tout soit assez fort pour soutenir le choc d’une masse de deux cents livres pour le moins lancée au galop. Mais voyez-vous, Marvault, quel que soit le danger que l’on court, il y a là une minute étonnante, celle où la bête se décide de charger. Alors je l’attends, le genou de la jambe qui avance plié, l’autre jambe tendue en arrière, le plus loin possible. Je tiens mon arme fort court dans la main droite, j’appuie mon autre main sur ma hanche, je suis là comme un escrimeur le genou de ma jambe de devant servant de charnière à tout mon corps et me permettant sans autre mouvement d’ajuster mon coup. Car on n’en peut donner qu’un seul et encore faut–il que ce soit à la bonne place, à trois doigts près, entre l’oreille et l’épaule. Il faut attendre le choc et ne pas aller au-devant, demeurer bien solide, la jambe de derrière bien arrêtée en terre pour pouvoir le soutenir, garder toutes ses forces bien unies pour que l’animal furieux vienne s’enferrer sans rémission. A ce moment, il y a deux façons de porter le coup : entre le corps et l’épaule, de manière à soulever celle-ci et à enlever toute puissance à la bête de ce côté, mais le coup n’est pas beau car l’animal ne meurt pas subitement, ou bien plonger l’épieu en plein corps. Le heurt, dans ce cas, est bien plus rude, le danger plutôt passé. Touché jusqu’au cœur, l’arme enfoncée jusqu’à la bilotte, l’animal laisse jaillir son sang d’un jet comme le bras, il perd ses forces aussitôt et tombe aux pieds de l’enferreur … ».
« Par ici » souffla Côme…
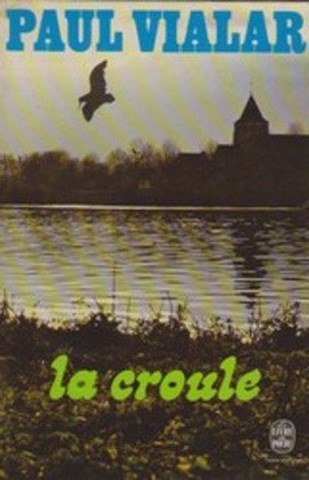 Un appel de trompe lointain. « Les chiens sont dans le bois » annonça Côme. Il n’y eut plus, de nouveau, que le silence feutré à peine troublé, parfois par le bruit que faisait un lapin furtif en tapant sur la feuille. Cela était si grand, si solennel, qu’on en retenait son haleine. Soudain des pies s’élevèrent, très loin là-bas, derrière la masse des arbres, on ne les vit pas mais on perçut leurs cris discordants puis, brusquement, alors qu’on avait cessé de les entendre, deux d’entre elles traversèrent l’allée très bas, virent les hommes, donnèrent un coup d’aile qui froissa l’air moite et les rejeta vers les cimes. Et Marvault, machinalement, répétait le dicton de son enfance : une pie, du malheur ; deux pies, la mort ! A un moment, il y eut un aboi lointain, aussitôt éteint, si bref qu’on se demandait si l’on avait bien entendu, et Côme, sans se retourner, fit un petit geste de la main qui une seconde quitta l’appui de sa hanche. Ce fut à cet instant qu’il écarta les jambes, planta son pied gauche bien en arrière, avança sa jambe droite et en plia le genou. Puis, les yeux tendus vers le cœur du bois sombre, il attendit… Le temps passait, si bien que, malgré lui, il se mettait à penser à autre chose. Après tout, les piqueux s’étaient peut-être trompés, il était possible que la harde eût vidé l’enceinte… Ce fut sur eux avant que Marvault fut sorti de son rêve, si vite ! Il y eut d’abord une sorte de roulement mais si sourd, tellement confondu avec le silence qu’on ne pouvait l’identifier, c’était comme un bruit de la terre en travail et quand on sut que c’étaient les bêtes, elles étaient déjà là… Elles allaient, le cou dans les épaules, à une étonnante vitesse, presque sans bruit si ce n’était celui du galop sur la terre molle, dans le sous-bois clair… Presqu’au même moment, la bête était là. C’était un énorme sanglier noir, un vieux, lourd et dur qui avait bien quinze ans, deux longues défenses sortaient de la barre de sa mâchoire et l’on voyait ses grès, les grosses dents d’en haut qui émergeait de son boutoir. Il était large du bourbellier et la poche de ses suites ballotaient en dehors de ses cuisses. Il allait passer sur sa lancée. Ce fut alors que Côme l’appela, le défia en quelque sorte. La bête le vit, entendit ce cri rauque et fonça. Elle le vit dans son élan, sans même un temps d’arrêt, elle dévia seulement en s’inclinant sur sa gauche, droit vers l’homme. Ce fut fait en un éclair, le temps que Marvault se retournât, il était trop tard, le grand noir était sur eux… Il y eut un heurt brutal, terrible, un grand craquement d’os broyés, de chairs déchirées, d’affreux piétinements. Le temps que Côme fit le tour de l’homme et de l’animal mêlés, trouvât l’endroit précis de la bête fouaillante pour l’estoquer, le mal était fait. L’épieu pénétra de toute la force d’un bras désespéré, alla jusqu’au cœur à travers la peau dure, le poumon coriace, un flot de sang jaillit, recouvrit tout, éclaboussa l’homme à terre et celui qui venait de frapper, puis après un coup de boutoir où il mit toutes ses dernières forces et qui, celui-là, était destiné à Côme, mais heureusement manqua son but, l’animal agenouillé s’écroula. « Vingt Dieux, fit Grâcieux, il est défoncé ». En effet, un bruit horrible sortait de ce corps mutilé. Cela ne venait ni de la gorge, ni de la bouche au coin de laquelle sourdait une mousse rosée, mais de la poitrine. Cela faisait, sous la tunique déchirée, comme un grand souffle entre les lèvres de la plaie. Maintenant qu’ils le portaient, à chaque pas cela recommençait, comme s’ils avaient transporté une outre à demie gonflée d’air…
Un appel de trompe lointain. « Les chiens sont dans le bois » annonça Côme. Il n’y eut plus, de nouveau, que le silence feutré à peine troublé, parfois par le bruit que faisait un lapin furtif en tapant sur la feuille. Cela était si grand, si solennel, qu’on en retenait son haleine. Soudain des pies s’élevèrent, très loin là-bas, derrière la masse des arbres, on ne les vit pas mais on perçut leurs cris discordants puis, brusquement, alors qu’on avait cessé de les entendre, deux d’entre elles traversèrent l’allée très bas, virent les hommes, donnèrent un coup d’aile qui froissa l’air moite et les rejeta vers les cimes. Et Marvault, machinalement, répétait le dicton de son enfance : une pie, du malheur ; deux pies, la mort ! A un moment, il y eut un aboi lointain, aussitôt éteint, si bref qu’on se demandait si l’on avait bien entendu, et Côme, sans se retourner, fit un petit geste de la main qui une seconde quitta l’appui de sa hanche. Ce fut à cet instant qu’il écarta les jambes, planta son pied gauche bien en arrière, avança sa jambe droite et en plia le genou. Puis, les yeux tendus vers le cœur du bois sombre, il attendit… Le temps passait, si bien que, malgré lui, il se mettait à penser à autre chose. Après tout, les piqueux s’étaient peut-être trompés, il était possible que la harde eût vidé l’enceinte… Ce fut sur eux avant que Marvault fut sorti de son rêve, si vite ! Il y eut d’abord une sorte de roulement mais si sourd, tellement confondu avec le silence qu’on ne pouvait l’identifier, c’était comme un bruit de la terre en travail et quand on sut que c’étaient les bêtes, elles étaient déjà là… Elles allaient, le cou dans les épaules, à une étonnante vitesse, presque sans bruit si ce n’était celui du galop sur la terre molle, dans le sous-bois clair… Presqu’au même moment, la bête était là. C’était un énorme sanglier noir, un vieux, lourd et dur qui avait bien quinze ans, deux longues défenses sortaient de la barre de sa mâchoire et l’on voyait ses grès, les grosses dents d’en haut qui émergeait de son boutoir. Il était large du bourbellier et la poche de ses suites ballotaient en dehors de ses cuisses. Il allait passer sur sa lancée. Ce fut alors que Côme l’appela, le défia en quelque sorte. La bête le vit, entendit ce cri rauque et fonça. Elle le vit dans son élan, sans même un temps d’arrêt, elle dévia seulement en s’inclinant sur sa gauche, droit vers l’homme. Ce fut fait en un éclair, le temps que Marvault se retournât, il était trop tard, le grand noir était sur eux… Il y eut un heurt brutal, terrible, un grand craquement d’os broyés, de chairs déchirées, d’affreux piétinements. Le temps que Côme fit le tour de l’homme et de l’animal mêlés, trouvât l’endroit précis de la bête fouaillante pour l’estoquer, le mal était fait. L’épieu pénétra de toute la force d’un bras désespéré, alla jusqu’au cœur à travers la peau dure, le poumon coriace, un flot de sang jaillit, recouvrit tout, éclaboussa l’homme à terre et celui qui venait de frapper, puis après un coup de boutoir où il mit toutes ses dernières forces et qui, celui-là, était destiné à Côme, mais heureusement manqua son but, l’animal agenouillé s’écroula. « Vingt Dieux, fit Grâcieux, il est défoncé ». En effet, un bruit horrible sortait de ce corps mutilé. Cela ne venait ni de la gorge, ni de la bouche au coin de laquelle sourdait une mousse rosée, mais de la poitrine. Cela faisait, sous la tunique déchirée, comme un grand souffle entre les lèvres de la plaie. Maintenant qu’ils le portaient, à chaque pas cela recommençait, comme s’ils avaient transporté une outre à demie gonflée d’air…
